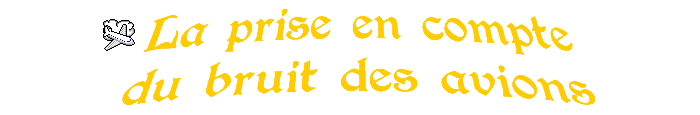
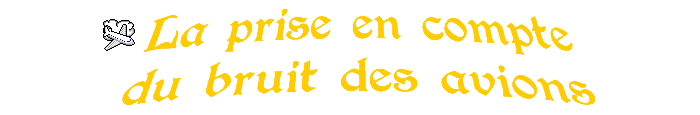
Évaluer l’exposition au bruit des avions autour d’un aérodrome, c’est pouvoir représenter à l’aide d’expressions et de modèles mathématiques la situation "acoustique" dans laquelle se trouvent les riverains. Pour cela, il faut tout d’abord choisir un indice, puis des hypothèses et des modèles de calcul. Ces derniers sont à la base de l’élaboration des contours de bruit qui délimitent les zones figurant sur deux documents cartographiques officiels: les plans d’exposition au bruit (PEB) et les plans de gêne sonore (PGS).
1- LES STADES DE L’ÉLABORATION D’UN INDICE ANNUEL D’EXPOSITION AU BRUIT
L’élaboration d’un indice annuel d’exposition au bruit des avions se fait en quatre étapes:
- choix d’une unité pour mesurer le niveau de bruit instantané,
- choix d’un descripteur pour un événement unique (un passage d’avion),
- choix d’un modèle de cumul pour une représentation quotidienne,
- choix d’une journée de référence pour une représentation annuelle.
Pour mesurer l’intensité d’un bruit à un moment donné, il faut choisir une unité. Une intensité sonore représente une grandeur physique de base: le flux d’énergie. L’intensité sonore est décrite sur une échelle logarithmique, en bels, décibels ou autre unité dérivée, car la sensation physiologique de bruit ne dépend pas uniquement de la valeur absolue des intensités, mais aussi de façon importante de la variation relative de cette intensité. Enfin, l’oreille humaine n’a pas la même sensibilité à toutes les fréquences: deux sons de même intensité mais de fréquences différentes ne seront pas perçus de la même façon. Afin de représenter la sensation physiologique d’intensité sonore, différents types de pondération, ou différents "filtres", ont été déterminés en laboratoire par les acousticiens. Ainsi, le dB(A) (décibel pondéré "A") est une unité construite pour représenter une sensation physiologique d’intensité sonore. Une autre approche consiste à pondérer le bruit par fréquences, non plus en fonction de la sensation physiologique de bruit mais en fonction de la gêne induite. Des travaux menés en laboratoire pour quantifier la gêne due au bruit des avions ont conduit à l’élaboration de l’unité PNdB (Perceived Noise Decibel). Une des caractéristiques du PNdB est la forte pondération des fréquences moyennes à élevées, qui sont les plus génératrices de gêne. Aujourd’hui, dans le monde aéronautique, le PNdB est l’unité de base pour la certification des jets et des hélicoptères (le descripteur utilisé pour ces appareils étant l’EPNdB, qui intègre la durée de l’évènement et des corrections pour les sons purs). Seule la certification des avions à hélices légers se fait avec l’unité dB(A) (le descripteur étant un niveau de crête en dB(A)). Cependant, pour ce qui est des indices d’exposition au bruit autour des aéroports, le choix de certains pays s’est porté sur le dB(A). La France, pour la construction de l’indice psophique, a retenu le PNdB.
Le deuxième stade de l’élaboration d’un indice correspond au choix d’un descripteur pour un événement unique (un passage d’avion). Il existe ici deux méthodes: l’une consiste à retenir un niveau de crête, l’autre à intégrer la durée en considérant un niveau représentatif de la "dose de bruit" (énergie totale véhiculée par le passage d’avion). Ainsi, si par exemple on utilise le dB(A) comme unité de mesure, on peut retenir le niveau de crête en dB(A) (Lamax) ou un niveau de type SEL (Sound Exposure Level - Niveau d’Exposition au Son) ou Leq (Leq-descripteur d’événement, à distinguer du Leq-indice). Le SEL est un descripteur utilisant le dB(A) et intégrant la durée: ce niveau, s’il était constant pendant 1 seconde, véhiculerait la même énergie (à quelques % près) que le niveau fluctuant correspondant au passage réel de l’avion. Afin de calculer le SEL, on ne considère pas exactement la durée de passage de l'avion (c-à-d. la durée d'émergence du bruit d'avion par rapport au bruit de fond), mais la durée pendant laquelle le bruit d'avion est compris entre son niveau max et (son niveau max-10dB). Le Leq en dB(A) est également un descripteur utilisant le dB(A) et intégrant la durée: le niveau en Leq, s’il était constant pendant la durée de passage de l’avion, véhiculerait la même énergie que le niveau fluctuant réel produit par l’avion pendant la même période. Pour connaître l’énergie véhiculée par un passage d’avion, le SEL suffit alors que le Leq-événement suppose que l’on connaisse en outre la durée de passage de l’avion. C’est pourquoi c’est le SEL qui est utilisé comme descripteur d’évènement dans le domaine aéronautique.
Le troisième stade consiste, à partir de ce descripteur d’événement, à construire un indicateur quotidien en :
- choisissant une durée d’exposition (durée pendant laquelle l’exposition au bruit est mesurée), généralement égale à 24h,
- découpant éventuellement cette durée d’exposition en plusieurs périodes distinctes (e.g. jour/nuit ou jour/soirée/nuit),
- appliquant des pondérations pour certaines périodes (nuit ou/et soirée) si l’on choisit cette option. Par exemple, une pondération des mouvements nocturnes peut être utilisée pour rendre compte qu’un passage d’avion est plus gênant la nuit que le jour.
- cumulant les impacts sonores produits par chaque mouvement. L’impact sonore sur une journée est supposé égal à la somme des impacts sonores correspondant à chaque mouvement, chacun de ces impacts étant supposé égal au logarithme de l’énergie acoustique de l’évenement. Ainsi, par exemple, l’impact cumulé de deux bruits de 60dB et de 40dB est supposé égal à l’impact d’un seul bruit de 60dB. De même, l’impact cumulé de deux bruits de 60dB est supposé égal à l’impact d’un seul bruit de 63dB.
- ramenant l’énergie totale cumulée à sa moyenne (par seconde ou par minute).
Enfin, le quatrième stade correspond à la construction de l’indice annuel à proprement parler. Pour cela, on construit une journée de référence représentative de l’exploitation réelle de l’aéroport. On retient une période d’exposition, qui peut aller du mois "le plus bruyant" de l’année à la totalité des jours de l’année. Les hypothèses de la journée de référence sont ensuite construites en appliquant à l’ensemble des avions et des trajectoires suivies des coefficients caractéristiques de la répartition statistique observée sur la période considérée. Des trajectoires nominales sont ainsi modélisées, ainsi que la dispersion autour de ces trajectoires. L’exposition au bruit est ensuite calculée en tout point autour de l’aéroport en cumulant les niveaux de bruit au sol résultant de tous les mouvements d’aéronefs. L’indice calculé pour cette journée de référence est représentatif de l’exposition annuelle au bruit des avions.
On pourra regarder à titre d'exemple un communiqué de l'Acnusa .
Cas particulier de la construction de l’indice psophique :
L’indice psophique est caractéristique de l’exposition au bruit journalière moyenne sur une année. Il est construit de la façon suivante:
- unité pour le bruit instantané: PNdB.
- descripteur d’un événement (un passage d’avion): bruit de crête en PNdB (exprimé en PNdBmax).
- durée d’exposition: 24h, découpée en une période de jour (6h-22h) et une période de nuit (22h-6h).
- pondération des mouvements nocturnes par un facteur 10 (ce qui revient à multiplier le nombre de mouvements nocturnes par 10, ou, ce qui est équivalent, à majorer de 10dB les niveaux sonores des avions pendant la nuit).
- cumul énergétique ramené à sa moyenne par minute.
- journée moyenne: trafic et répartition du trafic moyens sur les 12 mois de l’année.
2 - COMPARAISON ENTRE L’INDICE PSOPHIQUE ET LES PRINCIPAUX INDICES UTILISÉS DANS D’AUTRES PAYS
Dans le tableau ci-dessous sont présentés des indices utilisant des période d’exposition de 24h.
| Indice | Descripteur d'évènement | Pondération
soirée (dB) |
Pondération nuit (dB) | Moyenne énergétique | Pays utilisateurs |
| IP | PNd Bmax | 0 | 10 | par minute | France |
| Leq24h | SEL en dB (A) | 0 | 0 | par seconde | Le Royaume-Uni utilise un Leq mais de 7h à 23h |
| LDN | SEL en dB (A) | 0 | 10 | par seconde | USA |
| LDEN | SEL en dB (A) | 5 | 10 | par seconde | Pays scandinaves |
Pour chaque indice, nous avons indiqué le descripteur utilisé pour chaque événement et les pondérations éventuelles de nuit et de soirée. Ainsi, pour l’IP ou le LDN par exemple, tout mouvement de nuit est compté dix fois (ce qui revient à ajouter 10dB aux niveaux de bruit qu’il génère), afin de traduire qu’un mouvement nocturne est aussi gênant que dix mouvements diurnes.
La variété des unités, descripteurs et indices acoustiques rend difficile la comparaison de ce qui est fait dans les différents pays. Aussi a-t-il semblé important d’examiner les équivalences entre indices, aussi bien dans leur formulation mathématique que dans les résultats expérimentaux.
Il résulte des travaux effectués qu’il n’y a pas d’équivalence mathématique autre qu’une corrélation statistique entre l’IP et le Leq ou LDN. En effet, en raison de la différence entre les facteurs d’atténuation du bruit en PNdB et en SEL (la propagation d’un son dépendant de sa fréquence), les courbes isosonores obtenues en IP et en Leq (ou LDN) n’ont pas la même forme. Pour un cas d’étude donné, les déformations des courbes, apparaissant notamment en latéral au décollage, interdisent de donner une relation mathématique entre IP et Leq. Cependant, une formule de corrélation statistique peut être donnée. La relation entre l’IP et le LDN est la plus significative car le Leq, à la différence de ces deux indices, n’opère pas le pondération de +10 dB pour les mouvements de nuit (la relation statistique entre IP et Leq dépend donc de la part du trafic nocturne par rapport au trafic total sur l’aérodrome considéré). On a pu établir la formule de corrélation statistique suivante: IP ª LDN +19 (avec une précision de ± 4 "points"). Cet écart de 19 points est dû en partie au fait que l’indice psophique provient du calcul d’une énergie moyenne par minute, contre la seconde pour le LDN (ou le Leq où l'on a: 1minute=60 secondes et 10log60 = 17,8). Cependant, pour être plus précis, il importe d’examiner la situation réelle sur chaque aéroport en établissant et comparant les courbes isosonores dans les deux indices.
3 - CLASSIFICATION DES DIFFERENTS TYPES D'AVION
Les performances acoustiques de chaque type d’avion de transport sont caractérisées par trois niveaux de bruit déterminés selon des procédures définies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces trois niveaux de bruit correspondent à l’approche, au décollage à pleine puissance et au survol. Ils doivent respecter les limites fixées par l’annexe XVI à la Convention de l’aviation civile internationale.
On distingue actuellement trois générations d’avion :
- les avions « non certifiés » qui ne satisfont pas les limites de bruit fixées dans le chapitre 2 de l’annexe suivante ;
- les avions « chapitre 2 » qui satisfont ces limites mais ne satisfont pas celles fixées dans le chapitre 3 de la même annexe ;
- les avions « chapitre 3 » qui satisfont ces dernières limites. Parmi ceux-ci figurent des avions initialement certifiés « chapitre 2 » qui moyennant, le plus souvent quelques modifications ont pu être recertifiés « chapitre 3 ».
Le chapitre 3 a été
défini en 1977. Un nouveau chapitre est en cours d’établissement
à l’OACI.