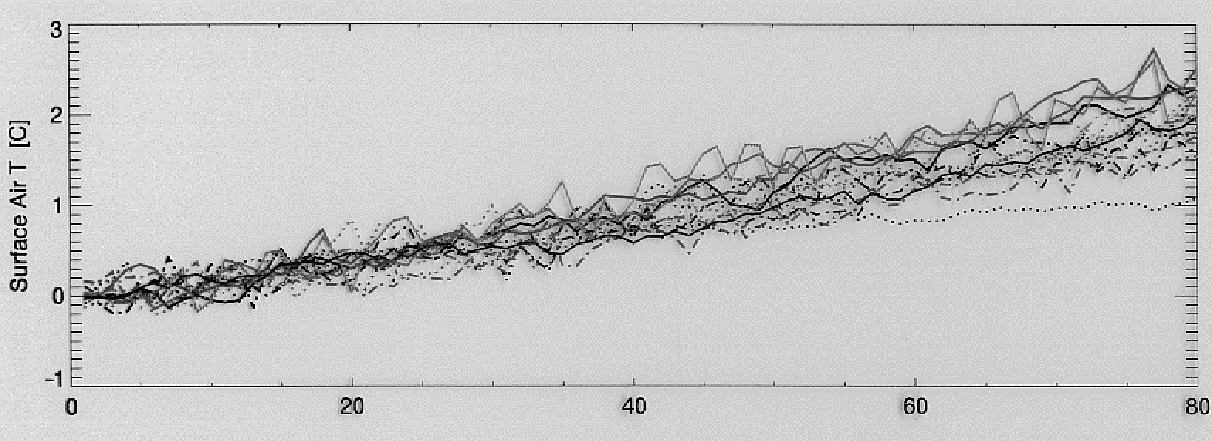
Les outils dont nous disposons actuellement pour tenter de savoir ce
qui peut se passer sont des modèles
climatiques, qui schématiquement visent à reproduire
sur informatique les lois qui gouvernent le climat pour voir
comment évoluent les choses en introduisant des perturbations
qui varient au cours du temps (notamment les
teneurs en CO2).
Environ 2.000 scientifiques travaillent directement sur ces modèles
de par le monde, et ont abouti de manière
indépendante à la réalisation d'une quinzaine
de modèles différents dont il est intéressant de comparer
les
résultats.
Les convergences qualitatives de ces modèles sont désormais
suffisamment fortes pour que l'on puisse en
admettre les principaux résultats :
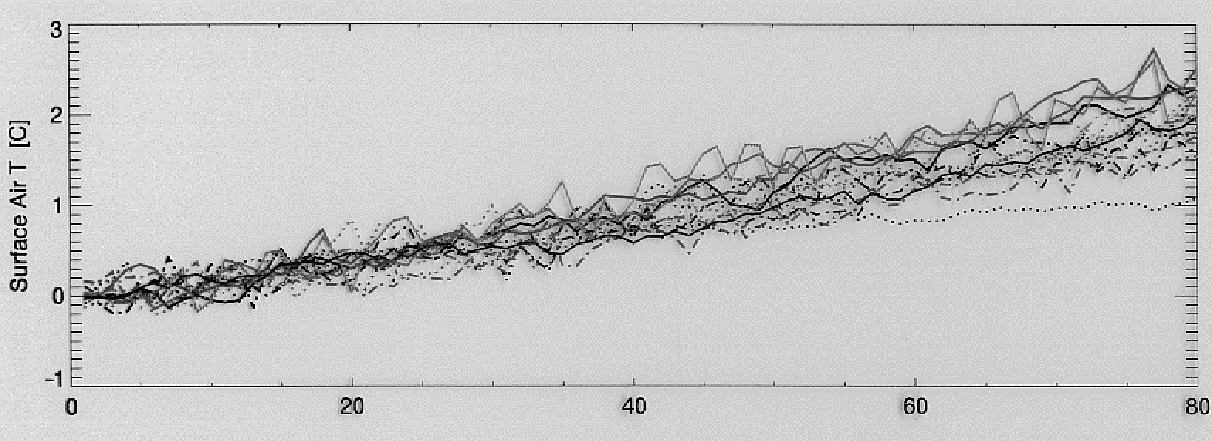
Les courbes ci-dessus (une courbe par modèle) donnent, en fonction des années, l'augmentation des températures moyennes annuelles par rapport à la situation actuelle (0 des ordonnées). On a pris l'hypothèse d'une concentration en CO2 qui augmente de 1% par an. Source IPSL (Institut Pierre Simon Laplace, rassemblant le Laboratoire de Météorologie Dynamique du CNRS (LMD, unité commune à l'Ecole normale, l'X, et Jussieu) et le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement du CNRS (unité mixte CEA - CNRS )
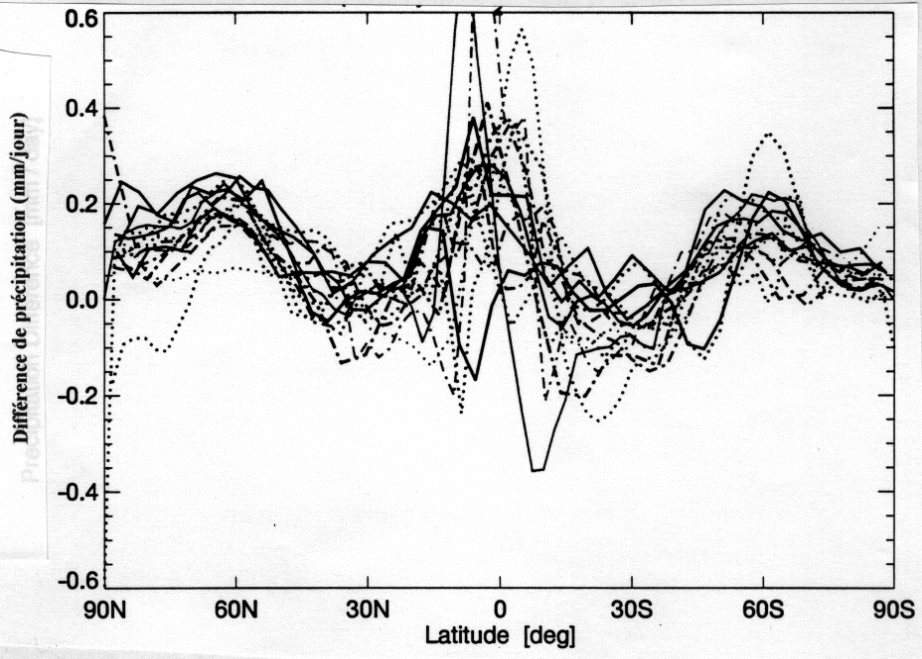
Les courbes ci-dessus (une courbe par modèle) donnent, pour chaque
latitude, l'évolution des précipitations moyennes annuelles
par rapport à la situation actuelle (0 des ordonnées) au
moment où la concentration de CO2 dans l'atmosphère aura
doublé, soit d'ici 60 à 80 ans en prolongation tendancielle.
Source IPSL.