-2- Evaluation de la
quantité de baryons dans l’Univers.
-3- Le phénomène de lentilles
gravitationnelles.
Aujourd’hui, la très grande majorité des spécialistes confirment
l’existence de la matière noire, qui représente un pourcentage d’environ 90 %
de la masse totale de l’Univers. L’hypothèse la plus simple pour chercher et se
représenter cette masse invisible est d’envisager son existence sous la forme
de matière que nous connaissons le mieux : la matière baryonique. Les
baryons sont les protons et les neutrons. En fait, par masse baryonique, on
entend l’ensemble de la matière telle que nous l’apercevons, tous les jours,
autour de nous : cette même matière qui constitue la Terre, le soleil et
nos neurones…
-2- Evaluation de la quantité de baryons dans
l’Univers.
L’étude cosmologique classique permet dévaluer la densité baryonique
dans l’Univers. En se basant sur la théorie du Big-Bang, on se place dans un
passé très lointain, durant les premières minutes du Big-Bang, la
nucléosynthèse primordiale se met en place : c’est le processus qui donne
naissance aux éléments simples dans des conditions de température et de densité
extrêmes. Les éléments Hydrogène, Hélium, Lithium, et Deutérium apparaissent
dans l’Univers naissant. Les mesures actuelles des quantités relatives de ces
éléments dans l’Univers nous donnent une idée de la densité baryonique de
l’Univers. Depuis 1999, les physiciens s’accordent sur une valeur de densité
baryonique de 0.019 +/- 0.002.
 Cependant, l’expérience Boomerang
( Balloon Observations of Millimetric Extragalatic Radiation and Geophysics
) réalisé en 1998 a remis en question ce modèle classique cosmologique. Le
projet consistait à envoyer un télescope de grande sensibilité de 1,2 mètre
de diamètre suspendu à un ballon. L’engin télescopique a ainsi parcouru plus
de 8000 kms en 1998 autour du Pôle Sud. On a ainsi pu cartographier les fluctuations
dans le bruit de fond cosmologique, la lumière fossile qui s’est échappée
de la soupe très dense et homogène qui existait 300 000 ans après le Big-Bang.
Cette lumière nous parvient encor aujourd’hui et son analyse a fourni une
nouvelle valeur de densité baryonique aux environs de 7,4 % +/- 1%. Les résultats de l’expérience sont encore
en analyse mais il semble aujourd’hui que cette valeur s’approche plus de
la vérité que celle émise par le modèle cosmologique classique. Les deux mesures
s’opposent principalement sur la date à laquelle elles sont faites puisque,
dans un cas, on se projette quelques minutes après le Big-Bang, et dans l’autre
cas, on se place 300 000 ans après le Big-Bang.
Cependant, l’expérience Boomerang
( Balloon Observations of Millimetric Extragalatic Radiation and Geophysics
) réalisé en 1998 a remis en question ce modèle classique cosmologique. Le
projet consistait à envoyer un télescope de grande sensibilité de 1,2 mètre
de diamètre suspendu à un ballon. L’engin télescopique a ainsi parcouru plus
de 8000 kms en 1998 autour du Pôle Sud. On a ainsi pu cartographier les fluctuations
dans le bruit de fond cosmologique, la lumière fossile qui s’est échappée
de la soupe très dense et homogène qui existait 300 000 ans après le Big-Bang.
Cette lumière nous parvient encor aujourd’hui et son analyse a fourni une
nouvelle valeur de densité baryonique aux environs de 7,4 % +/- 1%. Les résultats de l’expérience sont encore
en analyse mais il semble aujourd’hui que cette valeur s’approche plus de
la vérité que celle émise par le modèle cosmologique classique. Les deux mesures
s’opposent principalement sur la date à laquelle elles sont faites puisque,
dans un cas, on se projette quelques minutes après le Big-Bang, et dans l’autre
cas, on se place 300 000 ans après le Big-Bang.
Quelque soit la valeur avancée, il semble qu’elle soit insuffisante
pour expliquer la totalité de la matière noire. Cependant, il existe un
vrai débat autour de la nature de cette
masse noire baryonique, les astrophysiciens ont de plus du mal à s’accorder sur
la part que peut représenter la masse baryonique invisible par rapport à la
totalité de la masse manquante. Ces valeurs oscillent de 0,1% à 20% suivant les
cas. Cartographions les différentes théories et les différents chasseurs de
baryons noirs.
-3- LE PHENOMENE
DE LENTILLES GRAVITATIONNELLES.
Ce phénomène a été d’abord prédit par Einstein en 1936, comme conséquence
de sa théorie sur la relativité générale. Cinquante ans plus tard, c’est B. Paczynski qui a eu
l’idée de l’utiliser pour détecter la matière noire baryonique.
L’idée est la suivante : il faut observer le halo des galaxies où
l’on soupçonne la présence de matière noire sous forme baryonique. On braque
donc de puissants télescopes vers l’extrémité des bras de la Voie Lactée. On
espère alors repérée la signature de la présence de matière noire, par la
déviation qu’elle fait subir aux rayons lumineux d’étoiles situées en
arrière-plan, dans le Petit et le Grand Nuage de Magellan, deux petites
galaxies proches de la nôtre( à environ 190 000 années lumière ). La déviation
des rayons lumineux est très faible et donc n’est pas détectable. En effet,
cette déviation est de l’ordre de 10-3 secondes d’arc, et cette
valeur est très inférieure à la résolution des télescopes actuellement utilisés
qui est supérieure à la seconde d’arc. Cependant on constate un effet de
loupe : l’intensité lumineuse de l’objet en arrière plan augmente pendant
un certain temps, correspondant à l’alignement quasi-parfait de l’observateur
de la masse noire et de l’objet brillant. Ce phénomène transitoire dure durant
une période T telle que : T² a Masse lentille. Le
phénomène est évidemment très rare : la probabilité qu’une étoile donnée
dans le halo galactique soit l’objet, à t donnée, d’une amplification dépassant
30 % n’est que de 10-6 et il faut donc surveiller 30 millions
d’étoiles, pendant plusieurs années pour multiplier les chances de
visualisation des lentilles gravitationnelles.
La phase d’observation doit durer plusieurs semaines pour pouvoir
tracer la courbe de Paczynski, traçant la luminosité reçue en fonction du
temps. L’observation doit même se prolonger sur plusieurs années pour s’assurer
que l’on n’ait pas détecté une étoile à luminosité variable plus ou moins
périodique : ces dernières représentent 10 % des étoiles existantes. La
différence peut se faire en observant la courbe évoquée plus haut qui doit être
symétrique autour du maximum. A ce critère de symétrie, s’ajoute celui
d’achromacité, la courbe doit être la même quelque soit la longueur d’onde.
Enfin, la courbe doit répondre à un critère d’unicité du maximum. Il arrive
même que ces trois critères soient insuffisants pour s’assurer que l’objet
détecté soit effectivement une lentille gravitationnelle, c’est notamment le
cas si l’événement est trop long, alors le mouvement de la Terre induit un
phénomène de parallaxe dans les observations.
Monter un projet d’observation des lentilles gravitationnelles apparaît
comme un projet fou puisqu’il demande un investissement en temps et en argent
considérable. Il a pourtant été réalisé par différentes équipes européennes et
américaines.
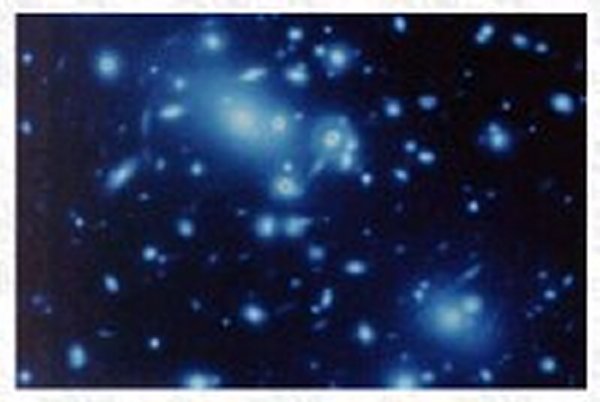
Exemple d’un
phénomène de lentille gravitationnelle.
C’est la zone un peu floue qui révèle un excès de luminosité et donc la
présence d’une lentille gravitationnelle.
EROS et MACHO Project sont les noms des deux
projets principaux qui ont été mis en place il y a une dizaine d’année par des
équipes européennes et principalement américaines. Il faut également noter un
autre projet de détection de lentilles gravitationnelles lancé par Paczynski,
celui qui a eu l’idée d’utiliser les prévisions d’Einstein pour détecter de la
matière noire baryonique.
MACHO signifie “Massive Compact Halo Objects”, c’est un projet
américain auquel est associé des universités anglaise, australienne et
canadienne. Il est dirigé par Charles
Alcock, chercheur du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie.
Pour ce projet, c’est un télescope posté à Camberra qui a été utilisé, celui du
Mount Stromb Observatory. EROS est un projet européen, le sigle signifie
« Expérience de Recherches d’Objets Sombres ». Des chercheurs du CEA
et du CNRS y ont participé et c’est notamment sous l’impulsion de Michel Spiro et de
Alain Milsztajn que le projet a pu se concrétiser. A. Milsztajn est
physicien à Saclay pour le CEA et M. Spiro est également physicien au CEA.
C’est avec un télescope basé dans un observatoire de la Cordillère des Andes
chilienne, à 2400 mètres d’altitude, que nos chercheurs ont scruté les Nuages
de Magellan depuis 1990. Le projet devrait s’achever cette année. Avec ces deux
projets s’est également construit un véritable réseau de communication entre
les différents observatoires internationaux. Ainsi lorsqu’un objet était
détecté, les observations étaient confirmées par différents astrologues du
monde entier.
Ces expériences étaient ambitieuses comme on l’a dit du fait de la
rareté du phénomène de lentilles gravitationnelles. L’investissement en capital
et en temps a été, par conséquent, considérable. Les observations ont commencé
dès 1990 et se sont poursuivis jusqu’à cette année. L’expérience ne s’est pas
soldée d’un franc succès puisque beaucoup moins d’événements ont été détecté,
que ce qui avait été prévu. Dans l’hypothèse où l’ensemble de la masse
manquante aurait été constitué de masse noire baryonique, c’est une centaine
d’événements qui auraient dû être détectés. En réalité, seulement une vingtaine
ont été répertoriés : ce qui confirme les résultats avancés par la théorie
cosmologique classique de nucléosynthèse primordiale et les mesures effectuées
par l’expérience Boomerang en 1998. Il y a encore certains événements dont on
n’est pas certain qu’ils s’agissent bien de Macho : il s’agirait peut-être
d’étoiles à luminosité variable. Ce sont des lentilles de taille assez
importante qui ont été détectées et non pas des microlentilles. Pour la plupart
des phénomènes, les temps d’observation étaient compris entre un et deux mois.
Par conséquent, les masses de lentilles observées doivent être comprises entre
le quart et la moitié de la masse de notre soleil. Cette masse n’est pas
caractéristique d’un objet en particulier et on ne sait pas aujourd’hui la
nature exacte de ces objets noirs. Plusieurs hypothèses sont proposées sur ce
sujet et nous y reviendrons un peu plus loin : nous verrons ainsi que les
chercheurs des deux équipes ne s’accordent pas vraiment sur cet encadrement de
la masse des lentilles gravitationnelles.
Tout d’abord, essayons d’éclaircir les oppositions entre les deux clans
américains et français concernant les observations effectuées durant ces dix
dernières années. La controverse porte ici sur l’emplacement des lentilles
gravitationnelles détectées. Le problème est le suivant : les télescopes
ont été pointés sur le halo plus ou moins sphérique de notre galaxie et ce sont
les étoiles du Petit Nuage de Magellan et du Grand Nuage de Magellan qui ont
joué le rôle des objets lumineux en arrière plan dont la luminosité a varié
lors du passage d’une lentille. La première conclusion consiste à dire que ces
objets se situent dans le halo galactique mais on peut aussi penser qu’ils
s’agissent de petites étoiles des Nuages eux-mêmes. La conclusion des
chercheurs de MACHO Project est que 20% des phénomènes observés
correspondraient à des objets
baryoniques situés dans le halo de la Voie Lactée. Pour les chercheurs
européens de EROS, les objets se situent tous dans les Nuages de Magellan et ce
parce que les étoiles qu’ils ont observées sont très éparpillées et parce que
EROS a relevé moins de microlentilles que le projet concurrent américain. Une
autre observation diffère entre les deux projets : en effet, pour un objet
qui serait situé dans le halo, le calcul de sa masse a amené les américains à
penser à une naine blanche, i.e. une étoile morte. Ce genre de naines blanches
est détectable simplement lors de son passage rapide dans une zone proche et
c’est sur cette observation que les chercheurs ne sont pas d’accord. Pour EROS,
rien n’a été constaté alors que pour MACHO Project, l’observation a confirmé
l’hypothèse initiale… Le dépouillement complet des expériences permettra sans
doute de trancher puisqu’il existe des différences de vitesse relative entre
les deux hypothèses de localisation. On pense aujourd’hui que très peu de
lentilles se situeraient dans le halo galactique : d’après le principe de
Copernic généralisé, on conclut ainsi qu’il n’y a pas beaucoup de matière noire
baryonique dans le halo des galaxies en général.
Une des autres questions qui préoccupe les astrophysiciens est la nature
des Machos. Sont-ce des naines blanches, des naines brunes, i.e. des étoiles
dont la pression interne n’est pas suffisamment importante pour enclencher les
réactions nucléaires qui font rayonner les étoiles, ou des trous noirs, à moins
qu’il ne s’agisse de nuages froids
d’hydrogène. L’hypothèse des nuages de gaz et de poussière pose des problèmes
puisqu’en général on sait les détecter par d’autres méthodes. Ils forment des
disques autour des galaxies. La possibilité de naines blanches pose problème
dans la mesure où ces étoiles mortes seraient trop nombreuses et le temps
écoulé pour qu’elles arrêtent de briller est beaucoup trop long. De nouvelles
observations effectuées en 1996 par le télescope spatial Hubble a permis de
voir qu’il n’y aurait pas plus de 10% de naines brunes dans le halo galactique.
Ces petites étoiles d’une masse d’environ 0.1 * Msoleil sont en
effet assez proche de nous et par conséquent sont détectables. Pour Joan
Najita, chercheur au NAOA, National Optical Astronomy Observatory, à Tucson,
les naines brunes représenteraient même moins de 0.1% de la masse du halo
galactique. La dernière hypothèse avancée est celle des trous noirs créés lors
de la naissance de la première vague d’étoiles massives. Cependant il existe
des conditions très contraignantes sur la masse de ces trous noirs ( elle
serait d’environ 10 fois la masse solaire). C’est pour éclaircir cette question
que les projets ont été prolongés jusqu’à la fin de cette année.
Finalement, Alcock, Spiro et Milszatjn s’accordent pour penser que la
contribution de la masse noire baryonique dans la masse manquante n’excéderait
pas les 20% et que les halos galactiques ne seraient pas spécialement riches en
objets de ce type. Alcock dit, à ce propos : « So we
know that MACHOs do not make up most of the dark matter in the galaxy. »
Une dernière voie de recherche de matière noire baryonique est
explorée : il s’agit de l’hydrogène moléculaire. On suppose ici l’existence
de nuage massif de particules n’émettant pas ou peu de rayonnement : par
conséquent, il est quasi-impossible d’en détecter la présence. C’est le cas de
nuage de H2 très froid, pense-t-on. Cette hypothèse permettrait
d’expliquer la disparition de matière baryonique, sachant que l’hydrogène est
un élément qui a été créé en quantité énorme lors du Big Bang. Des physiciens
travaillant dans un programme de la NASA espère pouvoir détecter ces nuages
avec des instruments très sensibles aux rayonnements X. L’hydrogène moléculaire
est différent de l’hydrogène atomique bien connu, c’est pour cette raison qu’il
est vraiment difficile de le détecter : on utilise notamment du CO comme
traceur. Edwin A. Valentijn,
du Kapteyn Institute de Groningen en Hollande a toujours été convaincu par
l’explication (partielle) du mystère de la masse manquante par l’hydrogène
moléculaire. Dès 1989, il a mesuré la brillance de 2500 galaxies
spirales : il a constaté qu’elles étaient obscurcies par leurs propres
poussières interstellaires. Le chercheur néerlandais a même dit :
« S’il est bien établi qu’il existe dix fois de molécules d’hydrogène
moléculaire que d’hydrogène atomique dans la spirale des disques, alors
l’énigme de la masse manquante est résolue. » Cependant la détection qui
avait été faite dans un premier temps avec ISO se situait dans le domaine de
l’infrarouge alors que la détection optimale s’effectue dans le domaine de
l’ultraviolet lointain. Ainsi en 1999, la NASA a envoyé un satellite avec le
projet FUSE pour faire ces observations
dans l’ultraviolet lointain, les longueurs d’onde sont de l’ordre de 100 nm.
Les mesures sont loin de confirmer les premières effectuées : la situation
en est restée là.
Aujourd’hui, on est quasiment certain que le mystère de la masse
manquante est encore ouvert et en aucun cas résolu. Après la piste la plus
simple de recherche de cette fameuse masse noire sous forme baryonique, les
physiciens et astrophysiciens ont pensé à l’existence de particules plus
exotiques.