LE PROJET CHARLAS
I. Choix du site
Dès 1988, 3 sites d'implantation d'un barrage avaient été
recensés : Vabre sur un affluent de l’Agout et du Tarn, Laurélie
sur un affluent de l’Aveyron, et Charlas en dérivation de la
Garonne, alimenté par une adduction.
Le
site de Charlas, le plus en amont possible du bassin, et de plus grande capacité,
présente l’avantage de permettre à la fois la réalimentation
de l’ensemble de la Garonne - des Pyrénées à l’estuaire
- mais aussi des rivières de Gascogne et de la Neste d’Aure en
Hautes-Pyrénées. Par ailleurs, le réservoir étant
créé sur une plaine agricole loin de toute grande rivière,
il ne pèse pas sur l’écologie d’une rivière
ou d’un fleuve, ce qui n’était pas le cas des deux autres
sites.
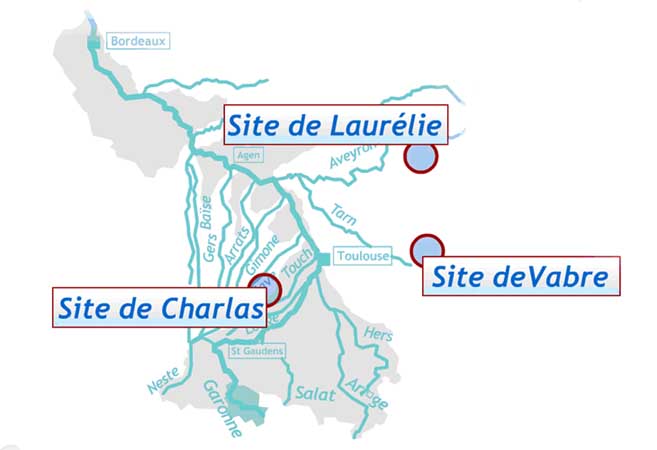
Le choix définitif du site de Charlas a été fait le 16 novembre 1990.
II. Description technique
Le
réservoir
Le réservoir s’étale sur une superficie d’environ
600 hectares, dont 550 immergés lorsqu’il est plein. Il se situe
à 380m d’altitude. Deux digues en terre argileuse, issue exclusivement
du site, créent une réserve maximale de 110 Mm3 : les deux tiers
(73 Mm3) sont affectés à la Garonne, le tiers restant (37 Mm3)
est affecté à la Gascogne. En année moyenne il est plein
de la fin mai à début août.
Ce
réservoir représente 50 % du coût total de l’investissement.
Le
remplissage
La prise d’eau est implantée en Garonne, dans l’ouvrage
hydroélectrique de Pointis-de-Rivière, sur la commune d’Ausson.
L’adducteur, qui achemine l’eau vers le réservoir, est
entièrement souterrain et fonctionne par gravité, c’est-à-dire
naturellement sans pompage. Sa longueur est d’environ 18 km, et son
diamètre de 2,5 m. Le débit de transfert est limité de
par sa conception à 10,5 m3/s.
La prise d’eau est fermée du 1er juillet au 31 octobre. En année
moyenne, par rapport à 2 milliards de m3 qui s’écoulent
en Garonne à Saint-Gaudens, environ 70 millions de m3 sont dérivés.
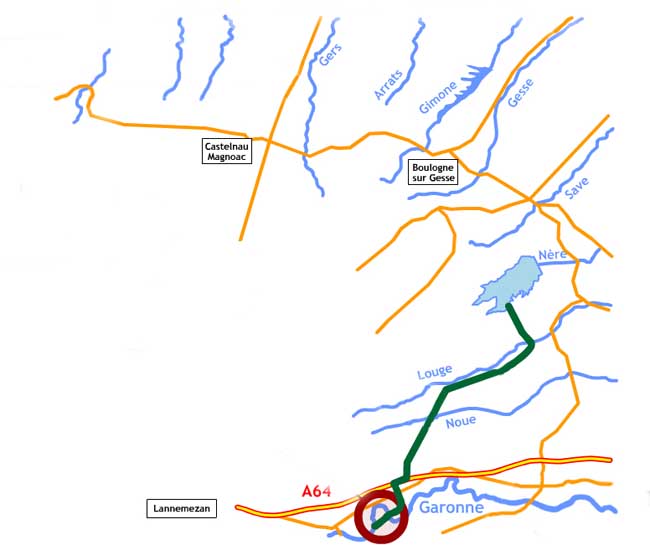
L’adducteur représente 25 % du coût total de l’investissement.
La distribution
L’eau est restituée vers la Garonne à partir du ruisseau
Nère puis de la rivière Louge. Vers la Gascogne, l’eau
est acheminée par un distributeur souterrain et également gravitaire.
Sa longueur est d’environ 32 km, son diamètre est de 2,8 m en
sortie du réservoir et de 1,2 m en fin de distribution. Il permet d’augmenter
de 30 % le débit de 7 rivières en Gascogne, c’est à
dire : la Save, la Gesse, la Gimone, l’Arrats, le Gers, la petite Baïse
et la grande Baïse.
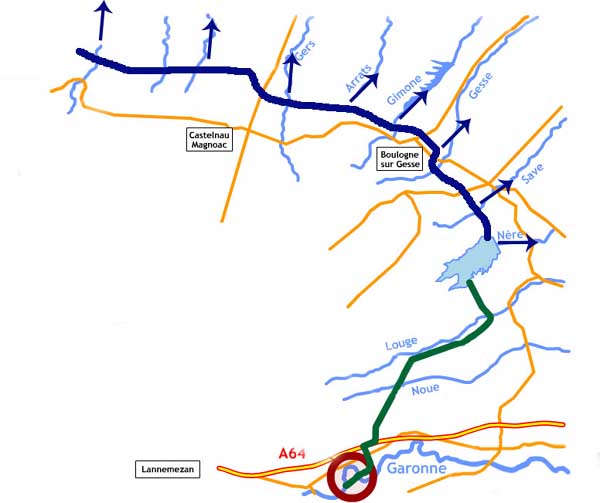
Le distributeur représente 25 % du coût total d’investissement.
En
cas de besoin, il est possible de diminuer, jusqu’à 5 m3/s, le
prélèvement du canal de la
Neste à Sarrancolin, afin de laisser cette eau s’écouler
naturellement dans la Neste aval, puis dans la Garonne amont, à partir
de Montréjeau.
Les rivières
qui bénéficient du soutien d’étiage sont donc :
- d ’une
part, la Garonne sur 440 km, des Pyrénées, depuis Montréjeau,
jusqu’à l’estuaire de la Gironde
- d’autre part, plus de 1000 km d’affluents en rive gauche de
la Garonne, c’est-à-dire, outre les 7 rivières de Gascogne,
la Neste, la Nère, la Louge, et le Touch.
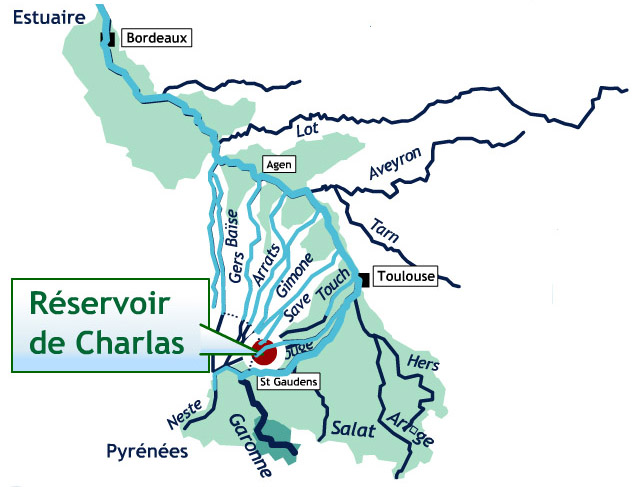
Conclusion
Le projet de création d’un réservoir sur le site de
Charlas est, selon le SMEAG,
une réponse au déficit structurel de la ressource en eau dans
le bassin de la Garonne. Le projet s’intègre dans un ensemble
d’actions (économies d’eau, optimisation des ressources
existantes), qui visent à concilier les usages économiques
et sociaux de l’eau et la préservation des milieux aquatiques.
La localisation de Charlas permet de répondre à trois fonctions
:
- le soutien d’étiage de l’ensemble du linéaire
de la Garonne, depuis son cours supérieur en Pyrénées,
jusqu’à l’estuaire,
- le soutien d’étiage des affluents (dont la Neste
en Hautes-Pyrénées et de neuf rivières de Gascogne),
- le soutien conjugué des économies régionales
du Val de Garonne et de la Gascogne.
Il faut aussi noter que les dépenses relatives à l'organisation
matérielle d'un débat public sont à la charge du maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, en l’occurrence
le SMEAG.