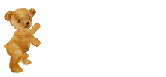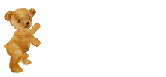L'ONF
Affilié au Ministère de l'Agriculture .
Après la Directive Ours de 1988, il crée une mission Forêt-Faune-Pyrénées, qui lui redonne une certaine indépendance. Il fait lui-même ses propositions, et le poids des expertises externes diminue ainsi.
Les forêts de la zone à ours représentent une étendue de 25 000 ha . Elles appartiennent aux communes ou aux syndicats intercommunaux, et sont gérées par l'ONF.
L'ONF a mis en place de lui même des mesures de réglementation des coupes :
• La règle des 2/3 : 2/3 de la surface forestière, à l'échelle d'un domaine vital d'ours, doit être laissé sans dérangement chaque année. Cela nécessite la réorganisation du travail pour concentrer les travaux dans le tiers restant
• Des contraintes de dates de travaux : on évite la période novembre - décembre d'engraissement automnal, et mars avril pour la sortie des tanières). On évite également certaines heures dans la journée
• Organisation de reports de coupe, si un ours se trouve dans la zone où l'on avait prévu de faire une coupe.
L'ONF souhaite mieux gérer la forêt non exploitée (30%) en réalisant des dessertes et en rattrapant, par des intensifications de coupes, le retard accumulé sur ces zones ; il faut rapidement se mettre au travail sur ces zones avant que les arbres ne soient trop vieux pour être exploitables :
• Desservir les zones par routes
• Reprendre rapidement les coupes
• Respecter l'ours un minimum.
Les projets de l'ONF sont trop faibles. De plus, ils veulent une intensification de l'exploitation, une augmentation des dessertes, avec une planification qui certes est bonne, mais trop faible en regard de la situation dramatique que connaît l'ours.
L'ONF prend certes de son propre chef des initiatives environnementales, grâce aux nombreux ingénieurs de terrain qui sont sensibles à l'environnement. Mais là est le problème : c'est un interlocuteur compétent, de très bonne volonté jusqu'à un certain point qu'il fixe lui-même, et au-delà duquel les négociations sont difficiles !
Il faut mesurer la dissymétrie des pouvoirs entre cette institution qui a le quasi monopole des expertises techniques, et des moyens de terrains importants (au moins 100 agents), face aux acteurs d'environnement aux moyens limités, aux faibles effectifs, aux faibles pouvoirs.
L'ONF a d'ailleurs vu d'un mauvais oil la création de l'IPHB. En effet, alors qu'auparavant il devait seulement présenter ses projets aux communes, il lui faut maintenant les soumettre à une délibération collective locale. Les procédures étaient alourdies et il perdait de sa force. Cependant il a fini par réaliser les moyens que cela lui apporte : il peut ainsi faire front commun avec les 16 communes concernées et obtenir des moyens supérieurs pour l'intensification de l'exploitation face à une opposition faible.