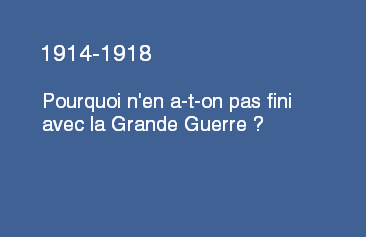
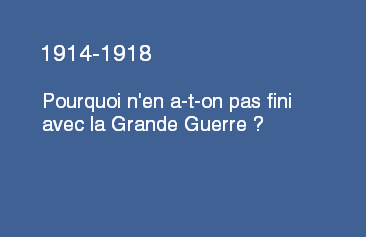
Les deux écoles s'opposent aussi de manière significative sur la nature des différents témoignages à utiliser dans l'historiographie de la Grande Guerre ainsi que de la place qu'il faut leur attribuer.
Par sa nature même, la Première Guerre Mondiale a engendré une très importante littérature du témoignage. Les historiens du CRID se servent ainsi beaucoup de témoignages modestes de soldats ayant combattu pendant les années du conflit pour défendre leurs thèses.
L'histoire du caporal Louis Barthas, ayant fait la guerre malgré ses convictions antimilitaristes prononcées, est souvent citée en exemple.
André Loez (rattaché au CRID) souligne pourtant la prudence avec laquelle il convient de traiter cet élèment essentiel dans le travail de l'historien.
"Ils tiennent aussi aux méthodes employées par les historiens pour les mettre en œuvre dans leurs travaux : se posent alors les questions du choix des témoignages, de leur représentativité, du constat et de la conciliation de leurs contradictions éventuelles, du risque que représente la montée en généralité à partir d’exemples isolés, et, plus profondément, de l’argumentation par exemplification."(A. Loez, 2005)
Audoin-Rouzeau et Becker se sont, pour leur part, très vite élevés contre ce qu'ils appelaient une "dictature du témoignage". Pour les deux auteurs, beaucoup de témoins ont occulté des pans entiers de leur expérience combattante.
Dès sa thèse en 1986, Audoin-Rouzeau refuse en bloc les différents témoignages au nom de la "déformation du souvenir". Il préfère s'orienter vers la presse des tranchées pour véritablement analyser le combattant des tranchées. C'est aussi à cette occasion qu'il introduit pour la première fois le terme de "culture de guerre".
De fait, rejetant aussi l'idée d'une propgande uniquement imposée, Audoin-Rouzeau a toujours à coeur de faire dialoguer témoignages d'intellectuels et expérience combattante.
La réaction à propos du succès du recueil Paroles de Poilus. Lettres et carnets du front (1914-1918) illustre bien sa position méfiante envers la simple collection de témoignages de soldats.
"C'est sans doute l'une des publications les plus médiocres jamais éditées à partir de sources directes écrites en 1914-1918. A ce titre, l'imense succès de sa "réception" est d'autant plus significatif : on ne peut sérieusement nier qu'un tel scandale éditorial a répondu aux horizons d'attente des Français sur la Grande Guerre. Outre l'opacité de la sélection des écrits, l'ensemble tend vers une version idéalisée du monde combattant, et les commentaires sont particulièrement significatifs d'une lecture tronquée de la guerre." (14-18, retrouver la Guerre, p. 12)
Ceci explique aussi en partie pour Audoin-Rouzeau les échos de la Grande Guerre dans une société uniquement préoccupée pour l'historien par des considérations contemporaines.
Le CRID s'est bien évidemment élevé contre un tel rejet en masse du témoignage, puisqu'il a pour voeu d'en faire une des composantes principales de son historiographie du conflit.
Au-delà de deux types différents de témoins de la Guerre, peut-être s'agit-il de deux manières véritablement différentes de questionner le témoignage, de l'analyser, et d'en tirer diverses conclusions. Y a-t-il vraiment eu, comme le soutenait Jean-Yves le Naour (voir Bibliographie), une "guerre des témoins" ?
