
Comme le requiert la directive européenne " Oiseaux ", les migrateurs ne doivent pas être chassé durant les périodes de reproduction et de migration prénuptiale. Les experts de l’ONFSH se retrouvent alors devant le problème fondamental de la détermination de ces périodes pour les différentes espèces. Leur travail se base alors sur un gigantesque travail d’études de publications scientifiques et sur la mise en place de nouvelles études, qui nécessitent souvent plusieurs années, afin de déterminer ces informations pour les différentes espèces chassables.
Dans ce but, l’ONC, ancêtre de l’ONCFS, a immédiatement réagi à la directive européenne en créant une base de ressources sur le sujet au travers d’une longue études de neuf ans qui a abouti, en 1989, à une synthèse, publiée conjointement par l’ONC et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Depuis, ces informations ne cessent d’être complétées par de nouvelles études qui permettent d’obtenir des résultats plus précis.
De manière à simplifier et clarifier au maximum l’étude de ce sujet aussi vaste que complexe, et dans l’unique but de présenter les techniques classiques d’approches, nous nous concentrerons sur le cas particulier d’une étude menée par l’ONCFS entre 1990 et 1997 et publiée en 2004 sur la Foulque macroule. La foulque est un oiseau proche de la poule d’eau, de la famille des rallidés, vivant dans les lacs et les étangs. La foulque n’est pas un oiseau migrateur, mais l’exemple est ici donné sur cette espèce de manière à simplifier l’approche qui se révèle être encore plus complexe dans le cas des oiseaux migrateurs. On notera toutefois que les techniques seront pour la plupart les mêmes.

La foulque macroule
L’étude a été menée en suivant le protocole classique de sélection des sites d’observation préconisé par le rapport MNHN - ONC de 1989. Il a donc fallu commencer par déterminer les sites qui allaient être suivi pendant les années de l’étude. Le MNHN proposait onze sites considérés comme les principaux sites de reproduction de la foulque macroule. A l’aide de ces propositions et d’une prospection bibliographique et de terrain, les scientifiques ont choisi leurs sites définitifs censés être les plus favorables à la nidification des oiseaux de cette espèce. Bien que cela ne soit pas recommandé dans le protocole, les sites suivis ont pu changer entre 1990 et 1997 afin d'observer au moins une trentaine de nichées par espèce et par an dans chaque département concerné par l’étude.
Ci-dessous est présentée la carte des sites étudiés (les points noirs représentent les communes importantes les plus proches des sites en question.
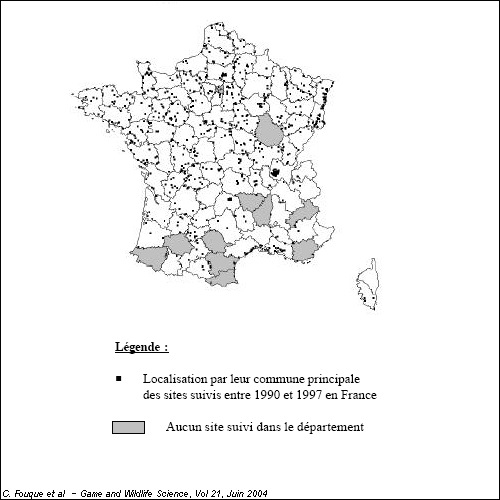
Chaque mois, tous les ans, de avril à août, les scientifiques se sont déplacés sur le terrain dans les sites concernés par trois fois afin de compter le nombre de nichées de l’espèce observables. L’intérêt de passer trois fois est bien entendu de trouver un plus grand nombre de nids (évalué à 20% de plus qu’en un seul passage). Lors de la visite sur le terrain, l’on repère trois données :
Il est en effet possible de déterminer facilement l’âge d’une foulque à l’aide de la couleur de son plumage. Pour chaque espèce, il existe des procédés conventionnés permettant d’estimer l’âge des individus.
On se rend bien compte que malgré la simplicité du protocole (recueil de seulement trois données), une telle étude représente un travail gigantesque d’une part par la difficulté du travail sur le terrain (trouver tous les nids, compter les individus, noter leur âge…) et d’autre part par le nombre important de sites à étudier pendant plusieurs années. La quantité de données finalement recueillie est donc elle-même impressionnante et il s’agit maintenant de les exploiter.
Nous citons ici le rapport de l’étude commentant les données obtenues et mettant notamment en avant le nombre et la nature des sites étudiés.
" Toutes les données ne répondant pas strictement au protocole tel que précisé ci-avant et dans le protocole ont été écartées de l'analyse. Un total de 918 sites différents, répartis sur 84 départements, ont été suivis durant au moins une saison complète de reproduction. Chaque année, le suivi d'en moyenne 300 sites répartis dans plus de 50 % des départements soumis à l'étude, a permis l'observation de 809 à 1 850 nichées de foulque macroule. "
Ci-dessous est présenté le tableau récapitulant le nombre de nichées de foulque observées lors des différentes années de l’étude :
| Année |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Total |
| Nombre de nichées |
809 |
1028 |
1296 |
1753 |
1828 |
1249 |
1850 |
1892 |
11305 |
Dans l’étude, il faut également tenir compte des conditions météorologiques qui peuvent jouer en rôle fondamental dans les comportements des individus. Nous citons à cet effet les commentaires des scientifiques :
" Les données concernant les conditions
météorologiques correspondant à la période d'étude
sont issues des bulletins mensuels et des bilans annuels établis par
Météo-France entre 1990 et 1997.
Durant cette période, les températures ont souvent été
au dessus des normales saisonnières en toutes saisons (en référence
à la période 1960 - 1990), sauf en 1996 où l'année
a été globalement plutôt fraîche et en 1991 où
une période de froid intense a sévi en février. L'été
a été particulièrement chaud en 1991, 1994 et 1995.
Entre 1990 et 1992, il y a eu une période marquée de sécheresse
en toute saison, notamment l'été, avec toutefois des précipitations
importantes en juin et octobre 1992. En 1993 et 1997, la pluviométrie
a été de saison ou en léger déficit au printemps
mais plutôt excédentaire au cours de l'été. L'inverse
a été vraie en 1994 et 1995 : les précipitations printanières
ont été excédentaires sur l'est, le nord de la France et
la région parisienne. En 1996, il y a eu un déficit pluviométrique
important toute l'année sur le nord de la France, qui a touché
aussi le sud au cours de l'été. "
Afin de pouvoir exploiter les données, on leur donne alors une forme plus parlante. Pour cela, on calcule différents paramètres pour chacune des nichées observées :
Le calcul se fait de la manière suivante :
On peut, de la même manière, à l’aide de renseignements théoriques, estimer la date à laquelle les petits vont prendre leur envol pour la première fois. On peut donc conclure en obtenant la date théorique à laquelle la nichée devrait prendre son envol.
Pour la foulque macroule, les données théoriques s’obtiennent par exemple grâce aux travaux de CRAMP&SIMMONS (1986) :
On établit alors un graphique sur la décade représentant les chronologies des pontes et des premiers envols (les deux graphes étant juste décalés dans le temps). Pour tenir compte de la variabilité entre les espèces, on utilise également un indice correspondant à la durée entre le premier janvier et la date de premier envol de la nichée.
La période de reproduction est définie comme le temps entre la date (ou décade puisque l’on raisonne toujours en dizaine de jours) à laquelle 10% des pontes ont été réalisées et la décade à laquelle 90% des nichées sont aptes au vol. Cette définition n’est pas universelle, elle a été choisie ainsi afin d’utiliser les même critères pour comparer les données sur les différentes années.
On peut ainsi calculer la durée de la période de reproduction pour l’espèce considérée, que l’on peut classer en différentes catégories :
On détermine également le type de calendrier de reproduction en classant dans trois catégories :
On peut ainsi classer les espèces dans l’une des douze catégories : longue-précoce, courte-tardif, moyenne-tardif…
Finalement, on effectue une analyse des distributions du délai au premier vol des nichées, ce qui est une étude assez complexe, nous citons le rapport :
" La variabilité entre les espèces,
entre les années et entre les régions a été étudiée
à partir des courbes cumulées de distribution du délai
au premier envol des nichées.
Une analyse descriptive de ces distributions a permis d'assigner les espèces,
les années ou les régions dans les catégories précoce,
normale ou tardive. Les regroupements de distribution ainsi obtenues ont ensuite
été vérifiées par des analyses de survie (LAPLANCHE
et al., 1987).
L'analyse de survie s'intéresse au délai temporel de survenue
d'un événement
donné dans un groupe d'individus (décès d'un individu ou
développement d'une maladie par exemple). Cet événement
est, dans notre étude, l'acquisition par les nichées de l'aptitude
au vol. Le test non paramétrique du log-rank permet de vérifier
l'hypothèse selon laquelle des distributions prises dans leur globalité
sont identiques entre plusieurs catégories.
Les tests ont été réalisés avec le logiciel SPSS
(SPSS, 1999).
Nous avons focalisé plus particulièrement notre attention sur
la fin de la période de reproduction, représentée par la
partie finale des distributions (appelée queue de distribution en terme
statistique). Pour comparer ces parties de courbes, nous avons calculé
les différences en nombre de jours entre les quantiles d'ordre 80 % des
différentes distributions [c'est-à-dire les valeurs de x (dates
ou délai au premier envol) pour y (pourcentage cumulé de nichées
ayant atteint l'âge du premier envol) = 80 %], et nous avons fait le même
travail pour les quantiles d'ordre 90 %.
Puis nous avons comparé les quantiles d'ordre 80 ou 90 % avec le test
de permutation proposé par EFRON et TIBSHIRANI (1998), programmé
sous le logiciel R (R DEVELOPPEMENT CORE TEAM, 2003).
Ce test permet de vérifier l'hypothèse selon laquelle les quantiles
à p% sont identiques entre les espèces, les années ou les
régions. Pour ces trois facteurs (espèce, année, région),
une simulation de l'absence de différence entre les distributions du
délai au premier envol des nichées a permis d'obtenir une distribution
de la statistique de test sous l'hypothèse nulle. Elle a été
réalisée en générant 1 000 permutations aléatoires
des données entre les différentes modalités d'un même
facteur, les effectifs initiaux étant conservés. La valeur de
la statistique obtenue à partir de cette nouvelle distribution théorique
a été comparée à celle du jeu de données
réel. Le degré de
signification du test est estimé par la proportion de statistiques de
test calculées sous l'hypothèse nulle strictement supérieure
à la statistique de test observée sur l'échantillon de
base. "
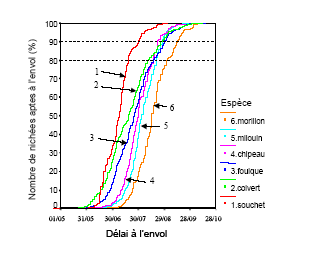
Délai à l’envol de différentes espèces (foulque macroule en bleu foncé)
On dispose donc finalement des périodes de reproduction de l’espèce considérée, et on peut fixer des critères plus ou moins exigeants quant aux périodes de chasse, en fonction de si l’on veut tolérer ou non que la chasse soit ouverte alors que certains oiseaux ont commencé à se reproduire. D’un point de vue statistique, il s’agit de savoir avec quelle marge on peut éventuellement empiéter sur la courbe de Gauss de reproduction des espèces.
Nous mettons à disposition des plus intéressés la " suite " de cet article, qui présente des commentaires sur la variabilité des résultats obtenus et, ce qui est important, sur la nature et l’impact des erreurs qui ont éventuellement pu être commises.
Voir : Discussion des résultats de l’étude des périodes de nidification et de reproduction
Cet article, qui correspond à la fin du rapport de l’ONCFS, est très technique et nécessite certaines connaissances préalables en statistique.
On pourra également se reporter à la bibliographie abondante sur ce sujet.