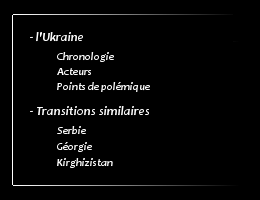l'Ukraine
Chronologie des évènements
Antécédent important :
Septembre 2000 : assassinat du journaliste Gueorgui Gongadze : ce journaliste de père géorgien publiait via internet un site d'informations : Ukraïnska Pravda.
Mars 2001 : manifestation à Kiev pour réclamer la « vérité » au sujet de la mort de Gueorgui Gongadze. Des enregistrements impliquant le Président Léonid Koutchma ont été rendus publics à partir de novembre 2000. Début 2001, dix à vingt mille manifestants venus de l'Ouest et du Nord de l'Ukraine défilent dans Kiev, brandissant des portraits de Gongadze. Certains vont jusqu'à demander la démission de Koutchma. Gongadze devient ainsi l'emblème de la lutte contre la corruption et le totalitarisme.
9 mars 2001 : la manifestation tourne à l'émeute. Un cordon de police tente de calmer la foule. Il y a des blessés et des arrestations. Le mouvement de protestation est stoppé net, mais le moral des ukrainiens gardera des séquelles.
La révolution Orange :
6 septembre 2004 : En pleine campagne présidentielle, le principal candidat d'opposition, Viktor Iouchtchenko, tombe subitement malade. Après quelques jours d'hospitalisation, il réapparaît défiguré et affirme qu'on a tenté de l'empoisonner pour l'empêcher de se présenter.
31 octobre : Premier tour de l'élection présidentielle. Viktor Iouchtchenko obtient 39,87% des voix et Viktor Ianoukovitch 39,32%.

21 Novembre : Second tour de la présidentielle. Les sondages à la sortie des urnes donnent la victoire à Viktor Iouchtchenko, mais les premiers décomptes accordent trois points d'avance à Victor Ianoukovitch. Le soir même, l'opposition dénonce les fraudes sur la place de l'indépendance, à Kiev.
22 Novembre : Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) confirment l'existence de multiples fraudes. Des tentes s'installent sur la place de l'indépendance, où la foule est de plus en plus importante. Les conseils municipaux de Kiev, Lviv, Ternopil et Ivano-Frankivsk votent leur soutien au candidat d'opposition.
23 Novembre : Les élus pro-Koutchma désertent les bancs du parlement. Viktor Iouchtchenko prête serment dans l'hémicycle rempli de députés de l'opposition. Julia Timochenko conduit une marche vers l'administration présidentielle. Léonid Koutchma appelle à résoudre le conflit par la négociation.
24 Novembre : La commission électorale centrale proclame la victoire de Viktor Ianoukovitch. L'opposition appelle à la grève générale. Léonid Koutchma accuse l'opposition de préparer un coup d'état.
25 Novembre : La cour suprême bloque la publication des résultats officiels, acceptant d'examiner la plainte de l'opposition. Le président polonais servira de médiateur. Au sommet Union européenne-Russie, l'élection Ukrainienne est le principal sujet de désaccord. L'UE rejette le résultat officiel, tandis que la Russie le qualifie de « transparent ». Les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne ont déjà critiqué le scrutin. En Ukraine, les télévisions montrent pour la première fois la manifestation de la place de l'indépendance, cédant aux demandes de journalistes en grève.

26 novembre : À Kiev, la foule entame le blocus de l'administration présidentielle et du cabinet des ministres. À Donetsk, lors d'un meeting pro-Ianoukovitch, les orateurs demandent un statut d'autonomie pour leur région. La première rencontre Iouchtchenko et Ianoukovitch depuis le vote, en présence de médiateurs internationaux, débouche sur l'idée d'organiser un nouveau second tour.
27 novembre : Le parlement vote une motion de défiance contre la commission électorale centrale et reconnaît les fraudes. Les partisans de Viktor Ianoukovitch manifestent à Kiev.
28 novembre : Julia Timochenko lance un ultimatum donnant vingt-quatre heures à Léonid Koutchma pour limoger le premier ministre. À Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine, un congrès de 3500 élus locaux menace de créer une république du Sud-Est dotée d'un statut d'autonomie. À Kiev, Léonid Koutchma demande la fin du blocus de l'administration présidentielle. Il réunit son conseil de sécurité. Le soir, les forces spéciales de la police reçoivent l'ordre d'intervenir, avant que l'état d'alerte soit subitement levé.
29 novembre : Léonid Koutchma condamne le séparatisme. Le directeur de Campagne de Viktor Ianoukovitch démissionne. La cour suprême commence à examiner la plainte de l'opposition.
30 Novembre : Début de la panique bancaire à Kiev. Léonid Koutchma accepte un nouveau vote mais semble vouloir recommencer toute l'élection. Le blocus des bâtiments gouvernementaux est levé pour quelques heures, puis reprend.
1er décembre : Les médiateurs internationaux sont de retour à Kiev et tiennent une réunion avec Viktor Iouchtchenko et Viktor Ianoukovitch. Le parlement échoue à voter la défiance contre le gouvernement. Il est en partie envahi par la foule qui manifeste à l'extérieur. Viktor Iouchtchenko sort pour retenir les manifestants, leur demandant de ne pas céder à la provocation.
2 décembre : Le parlement vote la défiance contre le chef du gouvernement, Viktor Ianoukovitch.
3 décembre : Léonid Koutchma refuse de renvoyer le chef du gouvernement. La cour suprême rend sa décision : elle demande la répétition du second tour dans les trois semaines.

4 décembre : Viktor Ianoukovitch, tout en dénonçant une décision politique, accepte de faire campagne pour le « troisième tour ».
5 décembre : Julia Timochenko assure que l'opposition a proposé des garanties personnelles de sécurité à Koutchma pour le jour où il quittera le pouvoir. Léonid Koutchma comme Iouchtchenko démentiront plus tard cette affirmation.
6 décembre : Les médiateurs européens sont de retour à Kiev pour une nouvelle réunion.
8 décembre : Le parlement adopte une modification de la constitution, change la composition de la commission électorale, adopte des amendements à la loi électorale, renvoie le procureur général, toutes mesures qui sont résultat d'un compromis négocié entre Léonid Koutchma et l'opposition et vont permettre au nouveau vote de se dérouler dans de meilleures conditions. Le soir même, Viktor Iouchtchenko demande aux manifestants de rentrer chez eux tout en restant mobilisés en vue du nouveau vote. Le village de tentes, cependant, demeure sur l'avenue Krechtchiatik.
11 décembre : Un nouvel examen médical de Viktor Iouchtchenko confirme qu'il a bien été victime d'un empoisonnement à la dioxine.
26 décembre : Le troisième vote se déroule dans le calme. Le résultat officiel annonce la victoire de Viktor Iouchtchenko avec 51,99% des voix contre 44,19%. Son adversaire conteste ce résultat et exerce tous les droits de recours.
20 Janvier 2005 : La cour suprême rejette la dernière plainte de Viktor Ianoukovitch.
23 Janvier : Viktor Iouchtchenko prête serment comme président d'Ukraine devant le Parlement puis sur la place de l'Indépendance.
Acteurs

Rinat Akhmetov : Considéré comme l'homme le plus riche d'Ukraine, il est, à trente-huit ans, le très discret chef du « clan de Donetsk », ce groupe d'industriels qui ont pris le contrôle de l'ensemble des usines du Donbass, la région la plus industrialisée du pays. Il finance largement le candidat pro-pouvoir Viktor Ianoukovitch, qu'il a contribué à faire nommer au poste de Premier ministre. Sa fortune se monte à deux milliards de dollars selon le magasine Forbes. Il possède de nombreuses usines métallurgiques, des mines de charbon, et le club de football de Donetsk, le Shahitor. Il n'apparaît que rarement en public, sauf pour aller voir jouer son club.

Mykola Azarov : Homme du clan de Donetsk travaillant auprès du président Koutchma, il fut chef de l'administration fiscale avant de devenir vice-Premier ministre du gouvernement de Viktor Ianoukovitch. Il a exercé l'intérim lorsque le premier ministre s'est mis en congé du gouvernement pour mener sa campagne en vue du troisième tour.

Gueorgui Gongadze : Journaliste assassiné en septembre 2001, à l'âge de trente et un ans. Son nom est devenu l'un des symboles de la protestation contre Léonid Koutchma. L'enquête a en effet démontré que les policiers du ministère de l'intérieur étaient liés à l'assassinat, avant que les recherches ne soient interrompues. Né d'un père géorgien et d'une mère ukrainienne, Gueorgui Gongadze dirigeait le site Internet Ukraïnska Pradva, où il dénonçait la corruption des proches du pouvoir.

Viktor Ianoukovitch : Premier ministre, âgé de cinquante-quatre ans, il est le candidat soutenu par le pouvoir lors de la présidentielle ukrainienne. Il fait campagne sur un programme de rapprochement de l'Ukraine avec la Russie et l'appui du clan de Donetsk, la grande ville de l'est dont il est originaire. Orphelin très jeune, il est passé par la prison avant de devenir ouvrier puis directeur d'une société de transport routier. Il a été gouverneur de la région de Donetsk à partir de 1997 puis chef du gouvernement à partir de 2002. Il dirige le parti des régions.

Viktor Iouchtchenko : Ex Premier ministre ayant créé la coalition Notre Ukraine, cet ancien banquier central âgé de cinquante ans fut le candidat de l'opposition lors de la présidentielle. Economiste de formation, fils d'enseignant de la région de Soumy, il a dirigé la banque nationale entre 1993 et 1999 puis fut Premier ministre de 1999 à 2001. Il a fait campagne sur un projet visant à rapprocher l'Ukraine de l'Union Européenne, se voulant le gardien des intérêts du pays, en particulier face à la Russie. Il est devenu président à l'issue de la révolution orange.

Léonid Koutchma : Elu président de l'Ukraine en 1994, cet ancien dirigeant d'une grande usine militaire, à Dniepropetrovsk, a mis en place en Ukraine un régime semi-autoritaire et corrompu, tout au long de ses dix années de pouvoir. Âgé de soixante six ans, il avait choisi de ne pas se présenter en 2004, apportant son soutien à son premier ministre Viktor Ianoukovitch. Né dans un kolkhoze de la région de Tchernigiv, il a fait partie de ces communistes ayant soutenu l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Devenu premier ministre, puis président, il a pris sa retraite politique au lendemain de la révolution et dirige une fondation qui porte son nom.

Iouri Kravtchenko : Ministre de l'intérieur au temps de l'affaire Gueorgui Gongadze, il était un fidèle du président Koutchma. Ecarté du ministère par Koutchma lorsque la pression européenne est devenue trop forte, il avait été nommé gouverneur de région puis recasé à la tête de l'administration fiscale. Au lendemain de la révolution, il a été convoqué par le parquet général pour s'expliquer sur l'affaire Gongadze. Le matin de l'audition, on l'a retrouvé mort chez lui.
Volodymir Lytvine : Président du parlement, il joue plutôt le rôle d'un conciliateur au moment de la révolution orange. Mais cet ancien chef de l'administration présidentielle était auparavant un fidèle de Léonid Koutchma. Au lendemain de la révolution, il a conservé sa place à la tête du parlement.

Iouri Loutsenko : Cet ex-journaliste de trente-neuf ans fut l'un des animateurs de la révolution orange. Membre du parti socialiste, proche d'Alexandre Moroz, il a co-dirigé les manifestations contre Léonid Koutchma au moment de l'affaire Gongadze. Il fut ensuite un des organisateurs de la révolution, apportant son expérience de ce premier mouvement de contestation. Il a été nommé ministre de l'intérieur au lendemain de la révolution.

Viktor Medvedtchouk : Avocat de formation, âgé de cinquante ans, le chef de l'administration présidentielle est le maître de toutes les intrigues politiques de la fin du mandat de Koutchma. Il dirige le parti social-démocrate réuni SDPU(o) qui est l'une des plus importantes factions pro-présidentielles au Parlement. Il contrôle 3 chaînes de télévision, et est fortement opposé au rapprochement entre l'Ukraine et l'UE.

Alexandre Moroz : Eternel chef du parti socialiste ukrainien, soixante ans, il fut candidat à la présidentielle. Il est arrivé en troisième position, loin derrière les deux principaux candidats puisqu'il a rassemblé un peu plus de 5% des voix. Il a rejoint la coalition de l'opposition entre les deux tours. Ancien président du parlement entre 1995 et 1998, il bénéficie d'une réputation d'honêteté.

Gleb Pavlovski : politologue russe, ce conseiller régulier du Kremlin fut envoyé en Ukraine durant toute la campagne électorale pour y aider Viktor Ianoukovitch.

Viktor Pintchouk : Député siégeant au sein de la fraction « Ukraine travailliste », ce milliardaire de quarante-trois ans est surtout le gendre du président Koutchma. Il a employé une part de sa fortune et de son influence pour améliorer l'image de son beau-père. Originaire de Dniepropetrovsk, il possède le groupe Interpipe, qui réunit de muliples usines sidérurgiques et de construction mécanique. Il est propriétaire de trois chaînes de télévision nationales privées. Peu avant la présidentielle, il a réussi à faire venir en Ukraine Henry Kissinger, Puis George Bush père. Depuis la révolution, il dit qu'il se consacre à ses affaires et affirme ne plus vouloir jouer de rôle politique.
Petro Porochenko : Député de l'opposition âgé de trente-neuf ans, il est un membre influent de l'état-major de campagne de Viktor Iouchtchenko. Ce riche entrepreneur a financé la création de la chaîne de télévision TV5, la seule a prendre parti pour l'opposition alors que toutes les autres étaient favorables au pouvoir. Après la révolution, il a été nommé chef du conseil de sécurité et de défense.

Oleg Rybatchouk : Député de notre Ukraine, âgé de quarante-huit ans, il fut l'un des proches conseillers de Viktor Iouchtchenko au sein de son état-major de campagne. Après la révolution, cet ancien banquier a été nommé vice-premier ministre en charge de l'intégration européenne.

Myloka Tomenko : Energique porte-parole de Viktor Iouchtchenko durant la révolution, âgé de quarante-deux ans, ce député fait partie des représentants de la nouvelle génération politique révélés par la révolution. Il fut à la tête de la commission pour la liberté de la presse au parlement. Il a été nommé vice-premier ministre pour les questions humanitaires dans le gouvernement issu de la révolution.

Sergueï Tigipko : Jeune président de la banque centrale, âgé de quarante-trois ans, il a dirigé la campagne de Viktor Ianoukovitch pour la présidentielle. En désaccord avec lui, il a démissionné avec fracas le 29 novembre au matin. Il prend acte dès ce moment de la probable victoire de Viktor Iouchtchenko à l'issue de la révolution et annonce son intention de prendre la tête de l'opposition à reconstruire.

Julia Timochenko : Ancienne dirigeante d'une société vendant du gaz, âgée de quarante-quatre ans, elle fut l'égérie de la révolution orange, adversaire inflexible de Léonid Koutchma. Dirigeante d'un bloc qui porte son nom au parlement, elle fut vice-premier ministre du gouvernement de Viktor Iouchtchenko, chargée des questions énergétiques. Elle a fait alliance avec Notre Ukraine avant la présidentielle. En janvier 2005, l'une des premières décisions de Viktor Iouchtchenko fut de lui confier le poste de Premier ministre.

Alexander Zintchenko : Le directeur de campagne de Viktor Iouchtchenko, âgé de quarante-sept ans, s'est montré l'un des adversaires les plus acharnés de Viktor Ianoukovitch. Depuis la révolution, il remplace Viktor Medvetchouk en tant que nouveau chef de l'administration présidentielle.
Points de polémique
La « Révolution Orange » a-t-elle été vraiment portée par le peuple ? Si l'image que nous en gardons à travers nos médias est celle de centaines de milliers de manifestants sortant de leur léthargie et renversant le pouvoir, cet avis est loin de faire l'unanimité.
Nombreux sont ceux qui pensent que ces manifestations très visibles ne sont qu'un leurre destiné à glorifier la transition qui a eu lieu, qui se réduirait alors à un sombre échange de pressions entre l'Occident et la Russie. En accordant le rôle principal au peuple, il s'agirait de donner un caractère héroïque à la transition et à cacher l'ingérence occidentale. Mieux, il s'agirait d'un moyen d'intervenir dans les affaires d'un pays par un biais qualifié de « cause noble » par tous. Ce point de vue est relayé par certains journalistes, du réseau Voltaire notamment.
Sans aller aussi loin dans la remise en question de la vision glorieuse des événements, la plupart des observateurs émettent des réserves sur le rôle déterminant de la mobilisation populaire. Des organisations telles que Pora ou encore les partis d'opposition ont été également déterminants à travers leur capacité à mobiliser les foules et à médiatiser les protestations. De nombreux journalistes affirment que ces mouvements - Pora l'a toujours nié - ont été financés par l'Occident. Le mouvement leur semblait trop bien organisé - médiatisation, la vague orange - pour être spontané.
Transitions similaires
Le cas de la Serbie
La chute de Milosevic

Président de la Serbie depuis décembre 1989, Slobodan Milosevic dirige son pays d'une main de fer, réduisant la liberté d'expression et contestant systématiquement les résultats des élections afin de se maintenir au pouvoir.
En 1996 commence une série de manifestations contre les fraudes aux élection municipales qui durera jusqu'en février 1997 mais sera un échec. Des manifestations dans le milieu étudiant à Belgrade provoquent en 1998 le départ du doyen de la faculté, artisan de la répression dans les milieux étudiants et constitue la première victoire.
Le scrutin présidentiel de septembre 2000 tourne au désastre pour Milosevic, qui l'annule. L'opposition, réunie en coalition pour les élections appelle à la grève générale. La crise se dénoue avec la marche du 5 octobre sur le parlement de Belgrade, qui réunit 700 000 personnes et provoque la fin définitive du règne de Milosevic.
Acteurs et controverses

Le rôle du mouvement Otpor (Résistance en serbe) est essentiel pour de nombreux observateurs. Ce mouvement étudiant a été fondé en octobre 1998 avec comme unique objectif le départ de Milosevic. Il compte plus d'une centaine de milliers d'adhérents en octobre 2000.
Leur action est non-violente : manifestations, distribution de tracts et leur symbole, un poing fermé en signe de protestation, est rapidement tagué sur les murs de la capitale. Ils s'attellent à faire prendre conscience à leurs aînés qu'il est temps d'agir et cherchent à les inciter à protester eux aussi. L'organisation est très peu hiérarchisée, de façon à ce que le régime ne puisse exercer de répression à leur égard.
Certains de ces membres ont reçu une formation à la lutte non-violente début 2000 à Budapest de la part de Robert Helvey, ex-cadre de la CIA et président de l'AEI. L'organisation a été financée par la NED et l'IRI. Au lendemain de la chute de Milosevic, certains membres fondent l'ONG « Centre pour la Non-Violence », dont le but est d'exporter leurs techniques de lutte pacifique, et qui aurait formé certains révolutionnaires Ukrainiens de Pora.
La campagne de l'opposition - la DOS, coalition de 18 partis - aurait été financée par les Etats-Unis et l'Allemagne. Grâce à cette aide, un important réseau de médias - radio, journaux et télévision - aurait notamment pu être mis en place.
Il est important de noter que si Otpor a finalement apporté son soutien à la DOS, le mouvement étudiant a toujours été très méfiant vis-à-vis des partis politiques et revendique son indépendance.
La révolution des roses

D'importantes fraudes électorales sont constatées par les observateurs de l'OSCE lors des élections législatives du 2 novembre 2003, qui donnent le président sortant Chaverdnadzé gagnant. La contestation régnait depuis de nombreux mois, l'organisation Kmara organisant de nombreuses manifestations.
Cependant l'opposant Mikheil Saakachvili est donné vainqueur des élections par les sondages indépendants effectués à la sortie des urnes. Il appelle la population à manifester pacifiquement et reçoit le soutien de tous les partis d'opposition. Les manifestants brandissent des roses en signe de non-violence. Le 22 novembre, ils font irruption à la session d'ouverture du nouveau parlement, qu'ils jugent illégitime.
Chavernadzé décrète l'état d'urgence mais l'armée ne le suit pas. Il démissionne le 23 novembre après une réunion avec l'opposition organisée par le ministre russe des affaires étrangères.
Polémiques

L'organisation étudiante Kmara -« Assez ! » en Géorgien - a eu une action calquée sur le modèle d'Otpor avant et pendant les élections. Fondée début 2003, ses membres sont formés tout d'abord par Liberty Institute, la principale ONG Géorgienne, et sont financés surtout par l'OSI mais également par la NED, Freedom House, l'IRI et l'Union Européenne. Ses membres ont en outre reçu une formation en Serbie avec Saakachvili dispensée par l'ICNC.
La parenté avec Otpor est évidente : outre l'organisation et l'action identiques, il suffit de jeter un coup d'½il au logo pour s'en convaincre.
La révolution des tulipes

Au lendemain du second tour des élections législatives du 13 mars 2005, jugés frauduleuses par une grande partie de l'opposition et les observateurs de l'OSCE, mais transparentes pour ceux de la CEI, de nombreuses manifestations éclatent dans le sud du pays. Elles s'étendront petit à petit à tout le pays et le 24 mars, le siège du gouvernement est occupé à Bichkek, forçant le président Akaev à fuir en Russie. C'est là-bas qu'il accepte de signer sa démission le 4 avril, entérinée par le parlement la semaine suivante. La révolution tire son nom du souhait des manifestants d'évacuer le pouvoir en place « avant l'éclosion des tulipes ».
Contrairement aux transitions Serbes ou Ukrainiennes, les manifestations ont souvent dégénéré en émeutes, faisant beaucoup de blessés. De nombreuses scènes de pillage souvent attribuées aux manifestants venus du sud ont eu lieu dans la capitale après le départ du président, faisant notamment trois morts et entraînant un état de chaos qui a duré quelques semaines. L'opposition, assez désorganisée et surprise par la tournure des événements, n'a pas vraiment réussi à gérer cette vague de protestation.
Kelkel

Tout comme en Serbie, un groupe étudiant a pris part aux manifestations : Kelkel - « Renaissance ». Difficile d'en savoir plus si ce n'est que certains membres ont été formés par Liberty Institute, une ONG au rôle déterminant dans la révolution des Roses. Le groupe dispose d'une forte visibilité et se définit comme une « organisation citoyenne de jeunes»