Les organisations internationales
Une organisation internationale (OI) est une organisation qui regroupe des personnes morales afin de coordonner des actions touchant plusieurs pays. Il existe deux types d’organisation internationale :
- OIG : Organisations Intergouvernementales qui sont des organisations publiques émanant de, et contrôlées par des gouvernements de divers pays.
- ONG : Organisation Non Gouvernementales qui émanent de membres privés de divers pays
Les OIG (Organisations Intergouvernementales)
Le FMI (Fond Monétaire International)

Le Fond Monétaire International (FMI)
est une institution internationale
dirigée par Dominique Strauss-Kahn depuis le 1er novembre 2007 et
regroupant 185 pays du monde entier. Crée en juillet 1944 lors de la
conférence de Bretton Woods afin d’essayer de garantir la stabilité du
système international de l’après seconde guerre mondiale, son rôle
principal est de « promouvoir la coopération monétaire internationale,
de garantir la stabilité financière, de faciliter les échanges
internationaux, de contribuer à un niveau élevé d’emploi et à la
stabilité économique et de faire reculer la pauvreté ». Il assure donc
la stabilité du système monétaire international et la gestion des
crises monétaires et financières en fournissant des crédits aux pays en
difficulté financière telles qu’elles mettent en péril l’organisation
gouvernementale du pays, la stabilité de son système financier, ou les
flux commerciaux avec les autres pays.
Depuis
1976 et la disparition d’un système de change fixe, le FMI a adopté un
nouveau rôle face aux problèmes d’endettement des pays en développement
dont les PMA font partis. Suite à cette nouvelle politique, les
interventions du FMI se sont multipliées dans ces pays à partir des
années 1980 afin de faire face au vaste problème de la dette des pays
du Sud. Ces derniers, suite aux pressions du FMI, ont été poussés à
s’ouvrir au commerce international et à orienter leur agriculture vers
une agriculture exportatrice (cacao, coton…). En rentrant sur ces
marchés ultra-concurentiel, cette démarche de libéralisation maximale
les a rendus bien plus vulnérables aux problèmes des subventions
agricoles. Cette concurrence est inégale et faussée car les pays du
Nord, fortement subventionnés, peuvent vendre leurs produits à des prix
très bas et face auxquels les PMA, qui ne sont pas subventionnés, ne
peuvent s’aligner.
Il faut noter que depuis les émeutes de la faim
de 2008, pour faire face à la pénurie de denrées alimentaires, le FMI a
changé point de vue et conseille maintenant aux PMA de
s’orienter
vers une agriculture vivrière.
«Le représentant du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal,
Alex
Segura, a exhorté le gouvernement sénégalais à "réajuster ses dépenses"
estimant que "le système budgétaire du pays ne tient plus et l'Etat
doit 150 milliards FCFA au secteur privé".
Pour
le responsable du FMI, le budget de l'Etat ne peut pas aujourd'hui,
soutenir ce niveau de subvention qui est "en train de
creuser, de
dégrader la position budgétaire du Sénégal avec un déficit qui devient
de plus en plus inquiétant.”
Dépêche Intelink du 17/05/08.
La Banque mondiale
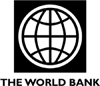
Créée le 27 Septembre 1945 sous le nom de Banque Internationale pour la
reconstruction et le développement et présidée depuis le 1er juillet
2007 par Robert Zoellick, la Banque mondiale
désigne deux
institutions internationales : la banque internationale pour la
reconstruction et le développement (BIRD) et l’Association
internationale de développement (IDA), créées pour lutter contre la
pauvreté en apportant des aides, des financements, des conseils, aux
États en difficulté.
La Banque mondiale a été créée
principalement pour aider l'Europe et le Japon dans leur
reconstruction, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais avec
le mouvement de décolonisation des années soixante, elle se fixa un
objectif supplémentaire, celui d'encourager la croissance économique
des pays en voie de développement africains, asiatiques et
latino-américains.
Ses objectifs ont évolué au cours des années.
Elle a récemment mis l'accent sur sur les pays en voie de développement
(PVD), et en particulier les pays les moins avancés (PMA), sur des axes
comme l'éducation, l'agriculture, l'industrie,…
En ce qui concerne
les subventions agricoles, la Banque mondiale reste neutre tout en
soulignant les différents problèmes qui pourraient aparaitre si on les
supprimait et ceux qui pourraient s’aggraver si on les conservaient.
«
Depuis trois ans, les prix mondiaux des aliments ont explosé, grimpant
de 83 %. Les prix du blé et du maïs, en particulier, ont triplé. Si la
situation perdure, la Banque mondiale prévoit que la flambée des prix
agricoles tuera 100 millions de pauvres. On évoque un "tsunami
silencieux". Plusieurs facteurs ont contribué à alourdir la facture
ali-mentaire […]. Mais un autre suspect est toujours pointé du doigt :
les subventions des pays riches. Elles rendent déloyale la concurrence
que livrent les agriculteurs du Nord aux fermiers du tiers monde. En
ces temps de famine, plusieurs réclament leur abolition. Mais attention
: éliminez les subventions, et les prix mondiaux vont... grimper !
C'est ce que démontre une étude de la Banque mondiale qui vient de
paraître. »
Texte de David Descôteaux tiré du Journal Les Affaires,
édition du 3 au 9 mai 2008.
OMC (Organisation mondiale du commerce)

L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC,
ou World Trade Organization, WTO) née le 1er
janvier 1995, est une organisation internationale qui s'occupe des
règles régissant le commerce international entre les pays. Au cœur de
l'organisation se trouvent les Accords de l'OMC,
négociés et signés (à
Marrakech) par la majeure partie des puissances commerciales du monde
et ratifiés par leurs parlements. Le but est d'aider, par la réduction
d'obstacles au libre-échange, les producteurs de marchandises et de
services, les exportateurs et les importateurs à mener leurs activités.
Mais, l’OMC est avant
tout un cadre de négociation où les gouvernements
membres se rendent pour essayer de résoudre les problèmes commerciaux
qui existent entre eux, le tout sur un mode démocratique au sens où
chaque Etat représente une voix, quel que soit son poids politique
et/ou économique.
Depuis la fin des années 1990 l'OMC
a été
l'objet de critiques de la part des mouvements alter-mondialistes.
Beaucoup critiquent aussi la différence de traitement entre sa capacité
à faire appliquer les réformes en matière de commerce (notamment
suppression des droits de douanes) en comparaison du peu d'intérêt
qu'elle manifeste à faire respecter les droits fondamentaux sociaux et
éthiques (pas de règle sur les salaires, sur l'environnement, sur les
droits syndicaux etc.). L'OMC
place le productivisme et les intérêts du
commerce au-dessus des considérations sociales (conditions de travail,
vie sociale et familiale), sanitaires (par exemple: règlement du
conflit relatif à la viande bovine aux hormones) et écologiques (le
gaspillage des ressources alimentaires et énergétiques n'est pas pris
en compte).
En 2001 a débuté le cycle de Doha qui portait surtout
sur la « libéralisation du commerce international » , et avait comme
objectif explicite le « développement » des pays en développement.
Cette négociation se focalisait notament sur l'agriculture et sur
l'amélioration de l'accès aux marchés des pays riches pour les produits
agricoles des pays en développement (PED). Parmis thèmes traités par
cette ronde de négociation l’ouverture des marchés et la réduction,
puis l’élimination, de toutes les formes de subventions à l'exportation
et de soutien interne à l'agriculture fait du cycle de Doha un élément
indispensable à notre controverse. Cette négociation a été relancée
début février 2007 (voir négociations actuelles)
«
L’analyse économique nous montre qu’il est parfois possible de remédier
efficacement à divers types de défaillances du marché en recourant à
des subventions. Elle nous montre également que les subventions peuvent
fausser les courants d’échanges si elles donnent un avantage
concurrentiel artificiel à des exportateurs ou à des branches de
production concurrençant les importations. »
OMC – Rapport
sur le commerce mondial 2006
«Les pays en développement, emmenés par le Brésil, demandent
particulièrement aux Etats-Unis de réduire leurs subventions agricoles,
estimant qu'elles faussent les prix mondiaux et pénalisent les
producteurs du Sud. Le cycle de Doha, qui aurait déjà dû aboutir à la
fin de 2004, continue à achopper sur ces questions. »
La Tribune.fr - 17/12/07
FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations)

Créée en 1945, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)
est une organisation spécialisée du système des
Nations unies regroupant 190 membres (189 États plus l’Union
européenne).
Son objectif unique et affiché est « Aider à
construire un monde libéré de la faim », sa devise, inscrite sur son
logotype, est « Fiat panis » (« qu'il y ait du pain (pour tous) »).
Pour cela, ils entreprennent des actions diverses telles que fournir
des informations et harmoniser les normes dans les domaines de la
nutrition, l’agriculture, les forêts et la pêche, fournir une
assistance technique aux pays en développement…
«Tout en reconnaissant que les subventions agricoles de l’OCDE aident
les pays importateurs nets de denrées alimentaires à maintenir la
facture de leurs importations à un faible niveau, M. Hartwig de Haen,
Sous-Directeur général de la FAO
responsable du Département économique
et social, affirme que «ces subventions envoient de faux signaux à ces
pays, les incitant à négliger leur propre agriculture»
Nouveau rapport
de la FAO sur le
commerce agricole et la pauvreté,
John Riddle Relations médias, FAO
Les ONG (Organisations non-gouvernementales)
OXFAM international(Oxford Committee for Relief FAMine)
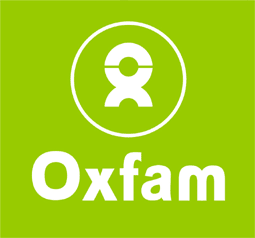
Créée en
1995 Oxfam
International est une confédération internationale composée de 13
organisations
non-gouvernementales indépendantes qui, à l’échelle mondiale, se
consacrent à
la lutte contre la pauvreté et l’injustice qui lui est intrinsèquement
liée.
Leur mission tend à créer un monde plus juste libéré de la pauvreté et
de
permettre aux individus d’exercer leurs droits et de réussir leur
propre vie.
Afrique Relance, ONU
Sources (Organisations internationales) :
La Tribune
Oxfam
Intelink