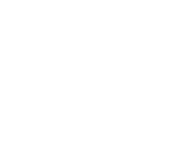
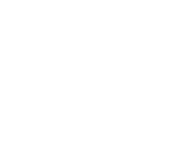
La définition qui nous est donnée par le Petit Robert est, à bien des niveaux, extrêmement instructive : il s'agit d'un « ouvrage didactique présentant, sous un format maniable, les notions essentielles d'une science, d'une technique, et spécialement les connaissances exigées par les programmes scolaires. » On voit ainsi se dessiner deux notions fondamentales pour un manuel scolaire :
la facette didactique et la conformité aux programmes fixés par l'Education Nationale.
Le manuel n'est pas le seul outil dont dispose aujourd'hui un enseignant, mais c'est le plus souvent son principal auxiliaire pédagogique. Il s'agit en effet d'un objet de médiation essentiel entre maître, élèves et parents ; en quelque sorte, le manuel est la vitrine d'un enseignement, le témoin auprès des parents de la pédagogie mise en place par l'instituteur.
S'il est au cour d'un dispositif pédagogique varié, le manuel scolaire ne doit pas pour autant constituer le cour même de la méthode d'apprentissage de la lecture : l'enseignant s'en sert comme support, mais il lui appartient de mettre en place les activités didactiques menant à l'éveil et à l'acquisition des concepts de lecture.
 C'est à Jules Ferry que les enseignants français doivent de pouvoir librement et collectivement choisir leurs manuels. En 1880, la France fut le premier pays au monde à confier « au personnel enseignant lui-même l'examen et le choix des livres que la libre concurrence des éditeurs met à jour incessamment ».
C'est à Jules Ferry que les enseignants français doivent de pouvoir librement et collectivement choisir leurs manuels. En 1880, la France fut le premier pays au monde à confier « au personnel enseignant lui-même l'examen et le choix des livres que la libre concurrence des éditeurs met à jour incessamment ».
Il n'existe ainsi pas d'organe de contrôle ou d'habilitation des manuels, dont le contenu est régi par la libre concurrence de marché qui s'exerce entre les éditeurs privés. Le ministère de l'Education Nationale ne peut intervenir que pour interdire les ouvrages contraires à la Constitution, la morale ou les lois, comme, par exemple, ce pourrait être le cas si l'ouvrage comportait des propos à caractère antisémite ; dans les faits, cette censure n'a jamais eu lieu de s'exercer.
 Néanmoins, les éditeurs de manuels s'efforcent de suivre les Instructions Officielles émanant du ministère et de les mettre en application: on peut constater une réelle correspondance entre les circulaires de l'Education Nationale et les nouveaux ouvrages proposés par les éditeurs. Ainsi, récemment, de nombreux manuels ont vu le jour en réponse aux Instructions Officielles de Jack Lang en 2002 ; on peut citer notamment le cas de Lire avec Léo et Léa, publié en 2004 chez Belin, ou de Super Gafi, publié en 2003 chez Nathan.
Néanmoins, les éditeurs de manuels s'efforcent de suivre les Instructions Officielles émanant du ministère et de les mettre en application: on peut constater une réelle correspondance entre les circulaires de l'Education Nationale et les nouveaux ouvrages proposés par les éditeurs. Ainsi, récemment, de nombreux manuels ont vu le jour en réponse aux Instructions Officielles de Jack Lang en 2002 ; on peut citer notamment le cas de Lire avec Léo et Léa, publié en 2004 chez Belin, ou de Super Gafi, publié en 2003 chez Nathan.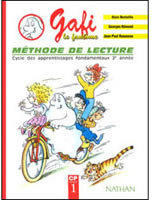
Les auteurs de manuels sont choisis par les éditeurs.et réciproquement. La rédaction d'un manuel est aujourd'hui un travail d'équipe pour tenter d'assurer la complémentarité des compétences, aussi bien pédagogiques que scientifiques. Des corps de métiers aussi variés que l'orthophonie, la neuropsychologie, l'inspection de l'Education Nationale et la sphère enseignante sont ainsi concernés par cette rédaction.
L'usage d'un manuel de lecture est-il indispensable ? Cette question est encore posée aujourd'hui, certains pédagogues et linguistes jugeant les manuels de lecture beaucoup trop directifs et leur préférant une démarche plus personnelle, propre à chaque instituteur. Ainsi, déjà en 1883, Jules Ferry incitait les maîtres à se séparer de cet outil : « Le livre est fait pour vous et non vous pour le livre ; vous pouvez vous réserver de choisir dans différents auteurs des extraits destinés à être lus et appris. »
Freinet notamment défendait cette vision selon laquelle les manuels n'ont pas de raison d'être et que les enseignants se doivent d'utiliser d'autres objets. Cela suppose évidemment que l'enseignant constitue ses propres fiches, ce qui prend un temps considérable. De plus, ses assises théoriques doivent être très nettes et précises
Pour l'élève, l'absence de manuel empêche de voir où il va ou de le montrer à d'autres, et notamment à ses parents qui n'ont ainsi aucune idée de l'enseignement qu'il suit ; le maître doit donc compenser ce manque par un dialogue beaucoup plus construit avec les parents d'élèves et une communication beaucoup plus efficace.
Toutes ces raisons expliquent que, dans les années 1970, une bascule s'opère, qui conduira à la situation actuelle où 84,2% des enseignants déclarent se servir d'un manuel de lecture ainsi que d'outils pédagogiques complémentaires comme des albums, des vidéos.
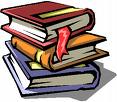 La libre concurrence des éditeurs permet à chacun des enseignants de choisir librement le manuel qui lui semble le plus adapté, sans contrainte d'aucune sorte. Néanmoins, cette profusion d'ouvrages présente un autre versant : face à des ouvrages très divers et qui se réclament tous de l'application des Instructions Officielles, quel choix faire et comment juger de leur efficacité ?
La libre concurrence des éditeurs permet à chacun des enseignants de choisir librement le manuel qui lui semble le plus adapté, sans contrainte d'aucune sorte. Néanmoins, cette profusion d'ouvrages présente un autre versant : face à des ouvrages très divers et qui se réclament tous de l'application des Instructions Officielles, quel choix faire et comment juger de leur efficacité ?
La même question se pose pour les parents d'élèves. Ainsi peut-on voir fleurir sur Internet des sites comparant les mérites de tel ou tel manuel et les publications traitant de ce thème ; citons à titre d'exemple Apprentissage de la lecture, Méthodes et manuels de Luc Maisonneuve ou la revue semestrielle bims (Bulletin d'Information sur les Manuels Scolaires) qui propose une analyse des processus mis en place par les derniers manuels parus, afin d'éclairer les parents d'élèves inquiets.
On saisit ainsi les enjeux sous-jacents : pour convaincre les parents d'élèves et les pédagogues qu'un manuel est efficace, il est essentiel que ses auteurs soient légitimés par l'Education Nationale ou, du moins, aient un minimum de bagages pédagogiques ; la question des illustrations et des exemples dont est pourvu le manuel est également centrale (voir à ce propos l'étude critique d'Eveline Charmeux sur Lire avec Léo et Léa).
 Les manuels scolaires étant le premier lien, et celui le plus visible, avec les méthodes d'enseignement mises en place par l'instituteur, ils sont les premières victimes des critiques adressées à leur encontre, en tant que leur digne représentant. C'est pour cela qu'elles suscitent une polémique aussi virulente. Les critiques adressées à la méthode Boscher par exemple ne sont réellement explicables que par le statut emblématique de ce manuel vis-à-vis de la méthode synthétique.
Les manuels scolaires étant le premier lien, et celui le plus visible, avec les méthodes d'enseignement mises en place par l'instituteur, ils sont les premières victimes des critiques adressées à leur encontre, en tant que leur digne représentant. C'est pour cela qu'elles suscitent une polémique aussi virulente. Les critiques adressées à la méthode Boscher par exemple ne sont réellement explicables que par le statut emblématique de ce manuel vis-à-vis de la méthode synthétique.
Le débat entourant les manuels de lecture est, ainsi, à bien des égards, représentatif de celui, plus large, des méthodes de lecture.