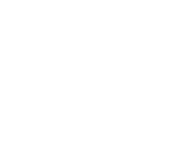
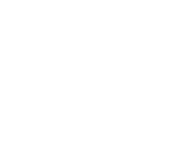
Voici quelques idées reçues bien trop souvent véhiculées à tort par les média et sur lesquelles il nous semble important de faire le point.
 Idée reçue numéro 1:
Idée reçue numéro 1:"la méthode globale est enseignée par de nombreux instituteurs et elle est la cause principale de l'illettrisme et des désordres sociaux."
Il s'agit là d'un amalgame entre trois concepts : la méthode "globale" proprement dite, introduite par Decroly et Freinet dans les années 20-30 et qui n'a jamais été rigoureusement appliquée, l'importance donnée en 1975 par le ministère de l'Eduaction Nationale sur les procédés de mémorisation et d'anticipation et, enfin, le recours à un petit stock de mots dans la plupart des méthodes synthétiques à entrée phonique ou des méthodes mixtes pour servir d'introduction au lien graphème-phonème.
La diabolisation de ce qui est « global » par le biais d'un amalgame entre ces trois stratégies d'enseignement jette le soupçon sur les programmes, sur les enseignants, et sur les manuels scolaires. Pourtant les programmes scolaires, nourris des travaux de recherche sur la lecture et son apprentissage, insistent sur l'apprentissage du code depuis les années 1970 et Luc Ferry lui-même, dans sa Lettre à tous ceux qui aiment l'école en 2002, affirme qu'"il est vain d'incriminer la fameuse "méthode globale", abandonnée pour l'essentiel depuis presque trente ans [et][...] diabolisée à bon compte".
 Idée reçue numéro 2:
Idée reçue numéro 2:"la méthode globale n'est qu'un mythe, elle n'a jamais été appliquée"
La méthode analytique (ou encore méthode globale) au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire telle que la conçevaient Célestin Freinet ou Ovide Decroly, n'a effectivement jamais été prônée par l'Education Nationale.
Néanmoins, en 1975, les circulaires Fontanet marquent l'avènement de la méthode idéo-visuelle qui hérite des méthodes analytiques et de la conception de la pédagogie que prônait Freinet ; ainsi, le principe "global" est-il cependant appliqué par quelques instituteurs, de même qu'il est mis en jeu dans les méthodes mixtes qui furent conseillées par l'Education Nationale pendant les dernières décennies.
 Idée reçue numéro 3:
Idée reçue numéro 3:"Actuellement, le débat oppose les partisans de la méthode syllabique et les partisans de la méthode globale"
La méthode analytique (ou globale) pure n'a jamais été rigoureusement appliquée, de même que la méthode synthétique (ou syllabique) pure ne représente plus qu'un pourcentage infime de cours préparatoires en France. Opposer deux conceptions aussi extrêmes n'a aujourd'hui plus de sens, bien que certains médias s'emploient à avancer cette caricature qui a le mérite de simplifier le débat et de fixer les idées.
La médiatisation excessive d'Eveline Charmeux notamment, qui défend les travaux qu'elle a menés dans les années 80 sur les méthodes analytiques, et de ses collègues nourrit les confusions et les stéréotypes.
 Idée reçue numéro 4:
Idée reçue numéro 4:"Avant, on savait mieux lire que maintenant."
Cette idée reçue a la vie dure dans les médias et les conversations de comptoir; quel poids lui donner? Il est bien difficile de répondre à cette question et une controverse semble opposer les statisticiens qui se sont penchés sur cette question.
De nombreux sites font référence à une étude de l'INSEE réalisée fin 2004 qui présente le taux de personnes en difficulté dans l'un des domaines fondamentaux de l'écrit et ce par tranche d'âge.
TRANCHE D'AGE |
PERSONNES EN DIFFICULTES |
De 18 à 29 ans |
14% |
De 30 à 39 ans |
16% |
De 40 à 49 ans |
18% |
De 50 à 59 ans |
26% |
De 60 à 69 ans |
34% |
Information et vie quotidienne, INSEE, 2004
Cette étude conclut ainsi que le taux de personnes en difficulté avec un des domaines fondamentaux de l'écrit augmente avec l'âge; une étude similaire en 2002 aboutit aux même conclusions concernant la lecture.
Certains linguistes interprètent ces chiffres comme la preuve d'une lacune de la méthode synthétique enseignée presque systématiquement il y a une cinquantaine d'années. Selon cette thèse, le principe du décodage, trop abstrait, ne serait pas bien retenu par les élèves qui l'oublieraient au fur et à mesure des années et présenteraient ainsi avec l'âge des difficultés de plus en plus marquées. L'enseignement de la lecture tel qu'il est effectué à l'heure actuel serait ainsi plus bénéfique.
Néanmoins, des collectifs pédagogiques mettent en cause la validité de ces chiffres et s'en réfèrent à d'autres études, très visibles sur Internet qui concluent, à partir des résultats obtenus par des collégiens à des épreuves du Brevet d'Etudes de 1920, que le niveau actuel des élèves a chuté de façon très préoccupante, particulièrement du point de vue de l'orthographe.
D'autres pédagogues expliquent cette différence de niveau par le fait que l'enseignement actuel met l'accent sur l'expression écrite, la communication et la compréhension et non plus sur l'orthographe; ils concluent qu'il est, à ce titre, difficile d'établir des comparaisons entre les capacités des écoliers actuels et de ceux des années 20.
On voit ainsi que la réponse à la question "lit-on mieux maintenant qu'il y a cinquante ans?" est loin d'être aisée et qu'il est difficile de pouvoir établir clairement des comparaisons entre ces deux époques, du fait tout simplement de l'évolution des moeurs et donc des buts poursuivis par l'Education Nationale.
Quels critères permettraient de déterminer objectivement le niveau d'un écolier et de le comparer à ceux qui l'ont précédé ou qui le suivront? Cette question n'est toujours pas tranchée.