

Des terrains transformés
« La forêt boréale canadienne présente une très grande richesse, tant au niveau de la biodiversité, de la pureté de l'air que de la qualité de l'eau. Sa conservation devrait être une priorité pour chaque canadien ». (Ministère de l'environnement canadien, Western Boreal Conservation Initiative) (34)
A l'échelle de la planète, le Canada est l'un des pays possédant le plus de surface forestière boréale ».
Le comité du Sénat sur la forêt boréale, 1999. (35)
La forêt boréale canadienne contient 35% des terrains marécageux mondiaux. (36) Elle s'étend sur 310 millions d'hectares à travers le pays et couvre environ 30% de la terre canadienne. (37) . Elle est l'habitat de nombreuses espèces animales et détient la plus grande diversité d'oiseaux migrateurs dans l'Amérique du Nord. (38) . On pourrait la décrire comme une mosaïque de forêts et de terrains marrécageux interconnectés entre eux.
Les réserves de bitumes en Athabasca sont entièrement situées dans le sol de cette forêt boréale. Le ministère de l'environnement canadien a prévenu que le développement des huiles lourdes présente « d'incroyables challenges pour la protection et le défrichement de la forêt ». 159(METTRE LIEN). En plus de retirer de grandes zones de vie aux espèces sauvages, les zones d'habitation entourant les mines devraient être moins fréquentées à cause du bruit et de la présence humaine. Certains écologistes préconnisent d'introduire des « corridors » non perturbés entre les « ilôts » de vie laissés aux animaux.
Le défrichement causé par les mines :
Lors de l'exploitation des huiles par des méthodes minières, les rivières sont détournées, les marrécages complexes sont drainés et la fine couche géologique supérieure de la forêt boréale est dépouillée. La future remise en place de la forêt proposée par l'industrie est radicalement différente de la mosaïque originelle de marrécages et de forêts. Les projets actuels proposent la création de terrains secs, de forêts à la place des marrécages et ne permettent pas la réhabilitation des tourbières (qui se regénèrent en quelques milliers d'années généralement). Cependant, ils proposent de nombreux points d'eau, sous la forme de lacs qui ne seront en fait que les futurs bassins de déchets d'exploitation. (39)
En plus d'être un habitat naturel pour de nombreuses espèces animales et de nombreuses plantes, les marécages et les tourbières sont de véritables éponges, régulant la circulation d'eau entre la surface et les eaux en profondeur. Ils absorbent l'eau de surface issue de la fonte des glaces et des orages d'été et rechargent les couchent profondes pendant les périodes de sécheresse. Ils permettent également de filtrer et de nettoyer cette eau. (40)

Lors des opérations d'exploitation en mine à ciel ouvert,
les rivières sont détournées, les marécages
asséchés
« Aujourd'hui, la région boréale est rentrée dans une ère de transformations induites par l'homme d'une intensité et d'une rapidité sans précédentes. Nombreuses de ces transformations sont potentiellement irréversibles à des échelles de temps humaines ». Global Forest Watch Canada(41)
Les compagnies doivent prouver qu'elles remettrons en état le terrain « dans un état équivalent à celui avant l'exploitation ». Cette dernière propriété étant définie comme la capacité pour le terrain de pouvoir supporter plusieurs usages et autant qu'avant l'exploitation. Mais l'emploi du terrain ne devra pas forcément être le même ». (42),(43)
A cause de la toxicité des acides naphtéiques, des inquiétudes demeurent à propos de la remise en état des décharges en des lacs à la fin des opérations minières devraient « laisser des niveaux en acides naphténiques permettant à ces derniers de se diffuser dans l'environnement ambiant ». Par exemple, le développement planifié et approuvé de quelques surfaces minières interférant avec le réseau d'eau de la rivière Muskeg pourrait polluer le réseau tout entier (44)
Environment Canada a établi que ces impacts sur la rivière Muskeg pourraient être irréversibles.(45)
Remises en état : Passé, présent, futur :
Seulement de petites zones ont été remises en état après les opérations minières qui ont débutées en 1960. Après 40 ans d'exploitation, aucune des zones n'a reçu pour l'instant de certificat de remise à niveau dans les normes. Suncor déclare avoir remis en état 858 hectares depuis le début de ses opérations en 1967, soit moins de 9% des terrains exploités. 168 Pour Syncrude, ce sont 4055 hectares qui ont été remis en état, sur les 18 653 exploités.(46)
En réponse aux critiques grandissantes, les industriels ont mis sur pied un plan de remise à niveau progressive, ayant pour but de réhabiliter les terrains dès que c'est techniquement possible. Cependant, même avec ce plan, aucune réhabilitation n'est prévue avant les 20 à 30 premières années d'un projet.

La réhabilitation des mines et des anciennes décharges présentent un vrai challenges
Certains émettent des doutes quant à savoir si ces remises à niveau seront nécessaires. Permettront-elles de retrouver les terrains existant avant l'exploitation?
Etant donné que des remises à niveau terrestres utilisant des matériaux déchets n'ont jamais été testées à très grande échelle, certains acteurs émettent des inquiétudes en ce qui concerne la stabilité à long terme des terrains recréés, de la survie des végétaux qui pourraient s'y implanter et de la possibilité de rendre la biodiversité à ces terrains. Malgré ces réticences, les opérateurs pensent que ces réhabilitations seront une réussite. Canadian Natural Ressources Ltd. a déclaré dans son rapport environnementale pour sa mine Horizon : « La maîtrise de la pollution tout au long du processus d'exploitation, liée à la réhabilitation après projet nous laisse penser que la réussite de ce projet sera de 100%. Les incertitudes liées au succès de la remise à niveau des terrains seront de toute évidence résolues avec les essais et la recherche actuels. » (47)
Cet optimisme n'est pas partagé par tous les acteurs. Le plan 2005 de gestion forestière de Al-Pac qui expose ses plans de coupe pour les 200 prochaines années, rapporte que « dans le cadre du développement des huiles lourdes, la production habituellement retenue pour répondre à la demande est interrompue. Les terrains devraient redevenir assez productifs dans 200 ans » ( le mot devraient est souligné dans le rapport ). La réhabilitation de la région des huiles lourdes sera une expérience à très grande échelle, mais elle ne semble pas être à même de restaurer un écosystème durable dans les 100 prochaines années.

Vue de la forêt boréale d'Athabasca
Des forêts morcelées :
Le morcellement des forêts a des impacts négatifs sur les espèces qui nécessitent des habitats étendus, comme certaines espèces d'oiseaux ou les grands carnivores. (48). Viennent s'ajouter les constructions de nouvelles route et chemins qui accroissent l'accès à la chasse et à d'autres activités humaines. Elles peuvent être de nouvelles menaces sur la vie sauvage.

Le caribou est l'une des espèces menacées. Il peut
être très sensible aux nuisanceset à la
réduction de son habitat
De nouvelles routes construites pour permettre l'accès aux zones d'exploitation et forment un réseau de zones déboisées. Bien que des progrès aient été faits pour réduire la largeur de ces routes, la région est couvertes de « cicatrices », comme le laisse voir la photographie aérienne ci-dessous.

Environment Canada a observé que l'activité liée au déboisement de la forêt boréale pour y construire un réseau de routes et chemins, était du même ordre de grandeur que celle de l'industrie forestière de la région. (49). Pour donner des ordres de grandeur, pour un kilomètre carré de forêt boréale, il s'est construit 1,8 kilomètres de routes et chemins. (50). Si l'activité forestière persiste à de tels niveaux et si le secteur énergétique se développe comme prévu, dans quelques dizaines d'années la densité moyenne de déboisement linéaire dépassera 5 kilomètres pour un kilomètre carré de forêt. (51)
Etant l'un des animaux les plus sensibles aux altérations de la forêt boréale, le caribou est utilisé comme un indicateur de santé de la forêt. La qualité de l'habitat du caribou a baissé de 23% sur les quelques décennies passées. De plus importantes dégradations sont attendues si le développement industriel se poursuit comme escompté. (52)
« Ce qui est en train d'arriver à la forêt boréale à travers les 3 450 kilomètres carré de surface exploitée ou prochainement exploitée par des techniques minières au nord est de l'Alberta, peut être légitimement décrit comme un holocauste écologique ».
Une marque grandissante :
La marque laissée par l'exploitation minière dans la région croît rapidement. Les mines prises individuellement s'étalent sur des surfaces de 150 à 200 kilomètres carré. Il y a approximativement 1807 concessions minières liées aux huiles lourdes en Athbasca.. Alors que ces chiffres peuvent sembler élevé, presque 80% des huiles lourdes sont encore disponibles à l'exploration et donc ne sont pas encore sous licence. (53)
Les exploitations minières des années passées et à venir vont directement affecter plus de 2000 kilomètres carré de forêt boréal. Cela représente environ la superficie de Tokyo qui abrite 12 millionsb de personnes. En 2003, l'Alberta Environment a rapporté que la région qui avait déjà été impactée par l'exploitation des huiles lourdes était de 430 kilomètres carré. Approximativement 90% de cette surface venait de l'exploitation de cinq sites : 3 mines et 2 site SAGD. (54)
Avant mi-2004, le montant total de terrain déjà impacté s'élevait à 950 kilomètres carré. On peut noter une forte croissance de ces chiffres.
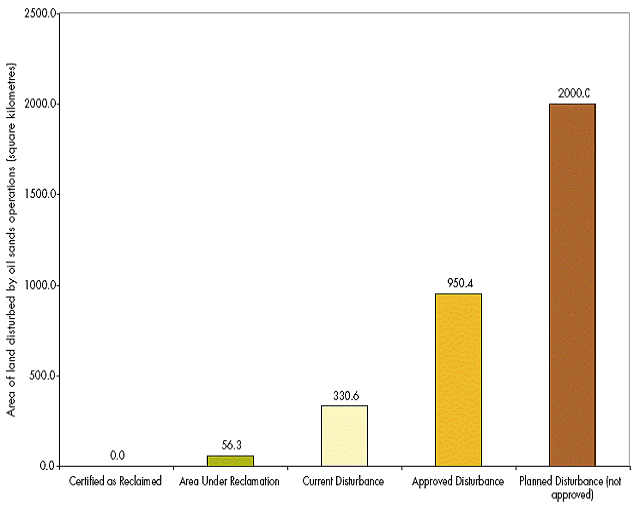
Troubles et remises en état de la forêt dans la région d'exploitation
des huiles lourdes en Athabasca (55)