
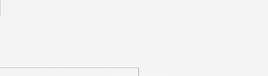


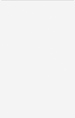
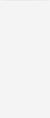
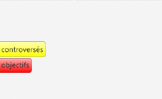


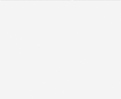

|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
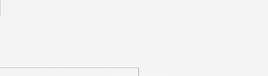 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
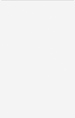 |
|
|
|
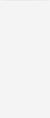 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
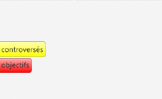 |
 |
 |
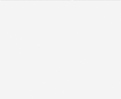 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les agences de notation |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avec cette note, le rôle premier des agences de
notation est de réduire ce que les économistes appellent les asymétries
d’information sur les marchés financiers : entre des émetteurs de dette
ayant tout intérêt à assurer de leurs capacités de remboursement et des
investisseurs ne disposant pas toujours des équipes d’analystes pour
étudier dans le détail les émissions, les agences fournissent une
opinion sur la capacité des émetteurs à ne pas faire défaut. Le rôle des
agences est devenu essentiel car la réglementation a, de facto, rendu
obligatoire pour un émetteur d’être noté avant de se présenter sur les
marchés. Cette technique de notation propre aux agences de
notation a été étendue par la règlementation
Bâle II
à l’ensemble des établissements de crédit. Même si la
règlementation prévoit
l’existence de notation interne, les régulateurs sont très attentifs à
ce que les modèles internes ne défèrent que peu des éléments fournis par
les agences, qui apparaissent comme des références en la matière. De
plus les modèles internes doivent intégrer très rapidement dans leur
notation des dégradations de notes opérées par les agences. Or, et c’est en cela que les agences de notation
interviennent dans la controverse, la réglementation prudentielle en
vigueur depuis Bâle II leur fait tenir un rôle important, puisqu’il
influe directement (par d’éventuelles provisions) et indirectement (par
les exigences de fonds propres) sur les fonds propres des banques De
plus, officiellement les notes publiées par les agences ne sont que des
opinions et non des labels ou autres garanties scientifiques. Cependant
de simples experts, les agences de notation sont devenues avec
l’instauration de la réglementation prudentielle actuellement, des
quasi-régulateurs de la titrisation et des produits structurés (Un
produit structuré est un produit conçu par une banque pour satisfaire
les besoins de ses clients. C'est souvent une combinaison complexe
d'options, de swaps, etc .... basée sur des paramètres non cotés,
définition de Vernimmen).
Elles fournissent aux banques qui créent ces produits structurés leurs
méthodes et leurs modèles pour évaluer le risque de défaillance. Elles
peuvent dès lors apparaître comme juge et partie. Les accusations portées contre celles-ci
Depuis le début de la crise, de nombreuses
accusations ont été portées à l’encontre de ces agences. Il leur est tout particulièrement reproché leur supposée
responsabilité dans la crise des subprimes et plus généralement dans
celle de la titrisation. Sont ainsi en cause :
-
leur absence de réelle
d’indépendance pour noter des structures qu’elles avaient contribué à
élaborer
-
l’utilisation d’une même
échelle de notation pour ces produits structurés et pour les produits
obligataires classiques alors même que la nature des produits et des
risques est bien différente. Leur absence d’anticipation, notamment de la crise de
liquidité, qui pouvait résulter des mécanismes de titrisation, a été
vivement reprochée. L’illustration la plus remarquable en est que peu
avant sa banqueroute Lehman Brother était encore noté « A » et que la
plupart des établissements qui ont été sauvés par les Etats en septembre
2008 gardaient encore une notation « investment grad »...
De nombreuses voix se sont également élevées contre
ces agences et leur mode de rémunération. En effet, les opinions
qu’elles émettent sont censées être indépendantes. Or depuis les années
70, les agences sont rémunérées par les émetteurs alors qu’elles
l’étaient auparavant par les investisseurs qui leur déléguaient ainsi
une partie du travail de traitement de l’information. On estime
aujourd’hui que 90% des revenus des agences proviennent des commissions
facturées aux émetteurs de dette. Avant la crise des subprimes, près de
50% du revenu des agences provenait des produits structurés, produits
dont elles avaient en amont, contribué par leurs conseils à la
structuration. Afin d’illustrer
le propos, il est intéressant de citer le rapport d’information du
député du Nord, M. Sébastien Huyghe, consacré aux « défaillances de la
régulation bancaire et financière ». La commission des Lois de
l’assemblée nationale a adopté le 23 décembre 2009 ce rapport qui
concluait les travaux d’une mission d’information parlementaire présidée
par le député des Ardennes et président de la commission M. Jean-Luc
Warsmann : « Proposition
16 : « Afin d’améliorer la transparence de l’information
financière, obliger les agences de notation, d’une part, à utiliser une
échelle de notation différente selon qu’il s’agit de produits structurés
complexes ou de produits simples et classiques et, d’autre part, à
affiner leurs notations en intégrant dans leurs évaluations le risque de
liquidité et les risque opérationnels, à côté de risques de crédit. » Proposition
17 : « Afin de mieux prévenir et gérer les conflits d’intérêts, ne plus
lier les recettes des agences de notation au montant des émissions
notées grâce à la mise en place d’un paiement au forfait des agences de
notation […] » Proposition
18 : « Créer les conditions d’une véritable concurrence entre
agences de notation et favoriser l’émergence de nouveaux acteurs
européens, davantage spécialisés sur certains secteurs d’activité que ne
le sont les grandes agences généralisées : d’une part en affirmant
que les obligations requises par les autorités publiques, en
matière de réglementation bancaire ou de l’épargne notamment peuvent
être satisfaites par d’autres agences que les trois agences historiques
[…] » Ce rapport
gouvernemental illustre les différentes accusations qui sont faites à
l’encontre des agences de notation, et encore une fois leur impact sur
la crise économique est manifeste compte tenu des réglementations en
place. Changement d’opinion dans le cadre de la crise de l’Euro
Ainsi a posteriori les différents acteurs de la
controverse reprochent aux agences de notation de ne pas avoir su
anticiper et donc dévaluer des entreprises qui se sont effondrées par la
suite. C’est dans ce sens que
des mesures ont été prises et le rapport gouvernemental précédemment
cité va dans ce sens.
Pourtant, le discours et notamment celui de la classe politique a
radicalement changé, quand les agences de notation ont abaissé la
notation de certains
états de la zone euro. En effet, le 27 avril 2010, Standard and Poor’s a
abaissé de trois crans la note de la Grèce, de « BBB+ » à « BB+ » la
reléguant dans la catégorie des investissements spéculatifs. Le même
jour Standard and Poor’s a dégradé de deux crans la note du Portugal de
« A+ » à « A-». Ceci a poussé Dominique Strauss-Kahn, directeur général
du FMI, à intervenir en déclarant qu’il ne fallait pas « trop croire »
ce que disent les agences de notation, « même si elles ont leur
utilité ». Le ton est plus agressif du côté de l’Elysée qui dénonce les
agences de notation « qui font la pluie et le beau temps » et
« amplifient » la spéculation dont est victime actuellement la zone
euro, en ajoutant : « c’est incroyable ! » Le discours n’est donc plus le même entre la période
de crise, où il a été reproché aux agences de notation de ne pas avoir
abaissé les notes à temps, alors qu’avec la crise de la zone euro c’est
au contraire la critique inverse qui est faite. Il apparait en tout cas
clairement que les agences de notation jouent un rôle controversé dans
l’économie actuelle que ce soit pendant la crise de 2008 et encore
actuellement.
Des torts partagés
Au-delà des critiques légitimes, les agences de
notation ne sauraient être tenues pour les seules responsables des
crises financières depuis le début du siècle. Il faut prendre en compte les responsabilités des
investisseurs, qui ont partiellement renoncé à leur responsabilité
d’évaluation du risque des actifs qu’ils détiennent et le délèguent aux
agences de notation ou celles des Etats et des régulateurs qui leur ont
donné un rôle de certificateur sans leur imposer de véritables cahiers
des charges. En fait, les agences participent d’un fonctionnement
général des marchés qui tend à passer de situations d’euphorie, où les
risques sont minimisés, à des situations inverses. On peut dire qu’elles
tiennent leur rôle dans ce type de fonctionnement au lieu de servir à le
contrecarrer. Mais peut-on leur en attribuer la seule responsabilité
alors que ce ne sont pas des institutions de régulations ? Pour l’économiste André Orlean, Directeur d’étude à
l’Ecole de Hautes Etudes en Scinces Sociales et à l’Ecole Normale
Supérieure, souligne, dans son
livre De l’euphorie à la panique : penser les crises financières : « l’autorité véritable, durant l’euphorie comme
durant la crise, c’est le marché lui-même ; c’est de lui que dépendent
les réputations et les profits ; c’est lui qui contraint les agences de
notation. Ce que l’on peut reprocher à ces dernières, dans cette crise
(des subprimes) comme dans les précédentes, c’est d’être toujours à la
remorque du marché pour ce qui est des tendances de fond. Pour cette
raison, ces agences n’ont eu aucun impact stabilisateur au cours de la
période analysée. Elles ont conforté les évolutions du marché, à la
hausse comme à la baisse ». (De l’euphorie à la panique : penser les
crises financières 2009) De même, dans la crise grecque, l’économiste Marc
Touati, écrit dans les colonnes du Monde du 29 avril 2010 : « les marchés sont comme ça. Une fois qu’on les
oriente dans une direction, ils ont du mal à s’arrêter. Et ce qui
devient dangereux, c’est que c’est "auto réalisateur". Plus les taux
d’intérêt augmentent, plus le risque de défaut augmente, et plus la
notation se dégrade. Mais il ne faut pas inverser le problème. Ce n’est
pas seulement un problème de notation et de dette publique, c’est
surtout un problème de faiblesse de la croissance. Aujourd’hui, dans la
grande majorité des pays de la zone euro, il n’y a pas assez de
croissance économique simplement pour payer les intérêts de la dette. Il
y a eu des erreurs de gouvernance économique de la zone euro ». Il est clair en effet que les agences de notation ne
pourrait être tenue pour responsable des gestions discutables des
dirigeants des structures (entreprises, collectivités…) qu’elles notent. |
||||||||||||||||||||||||||||||