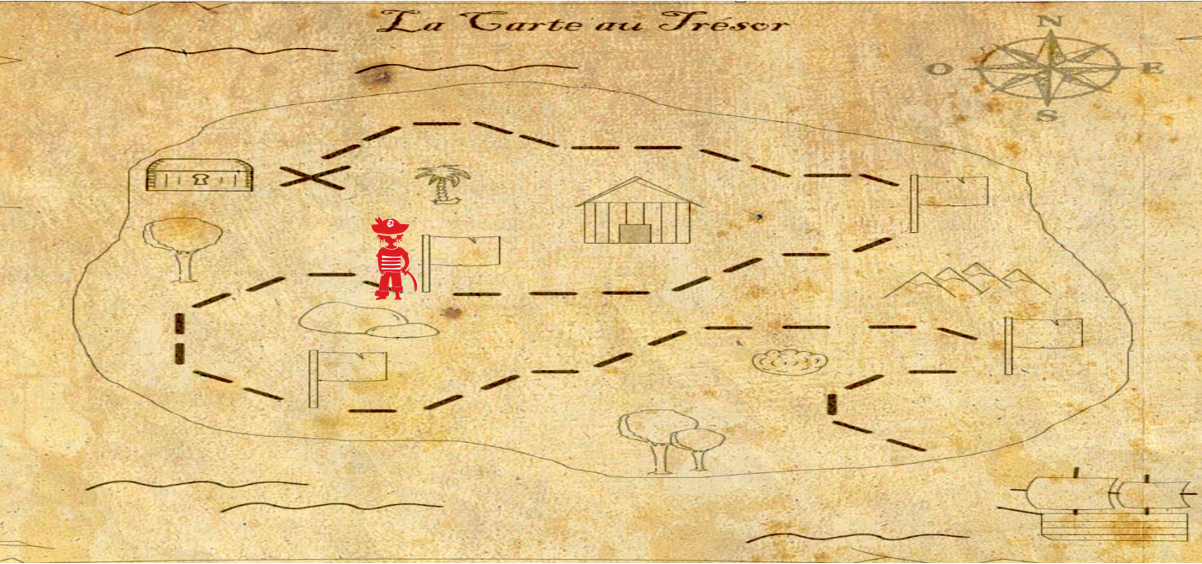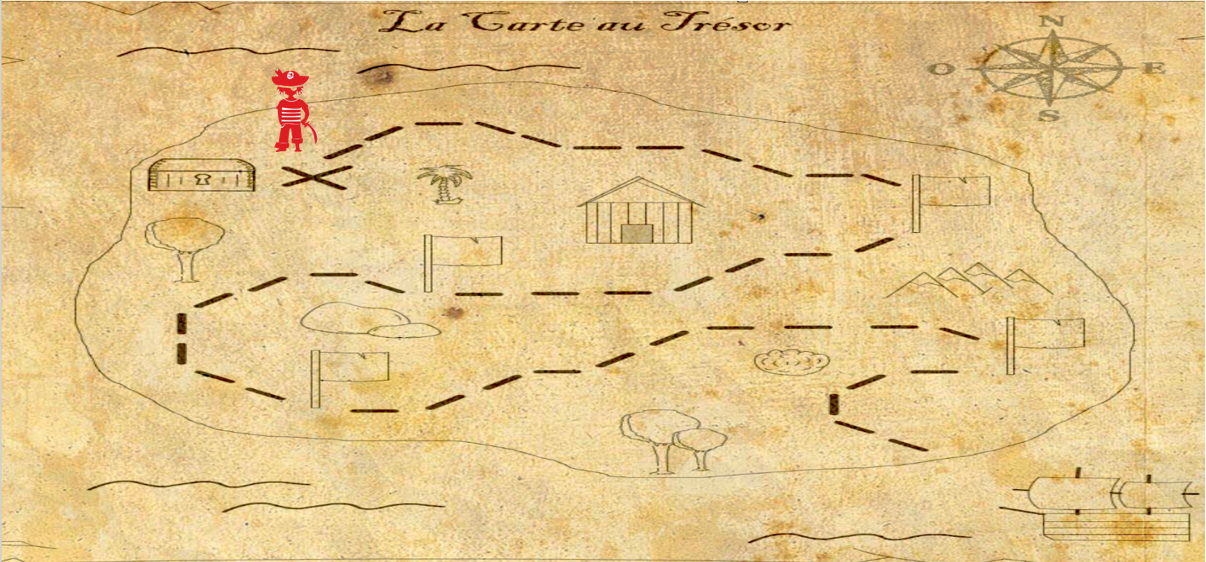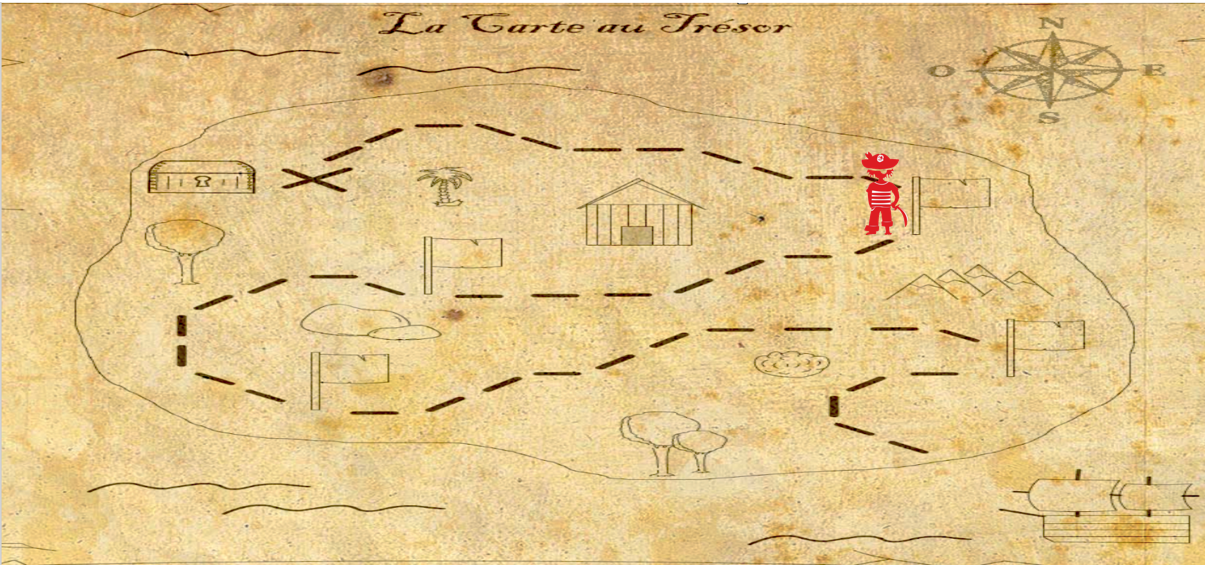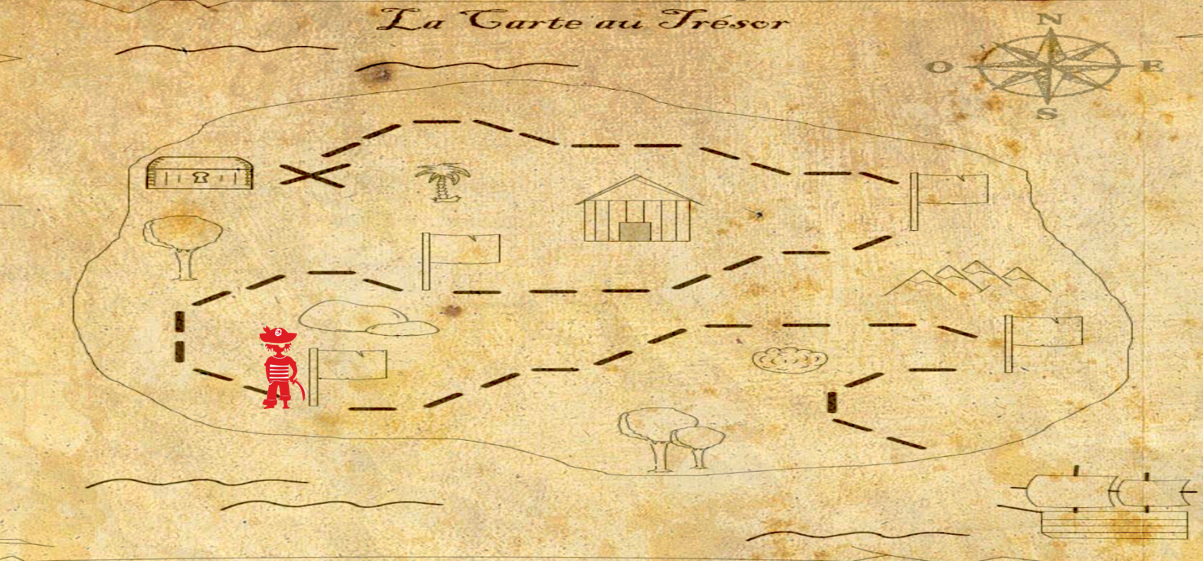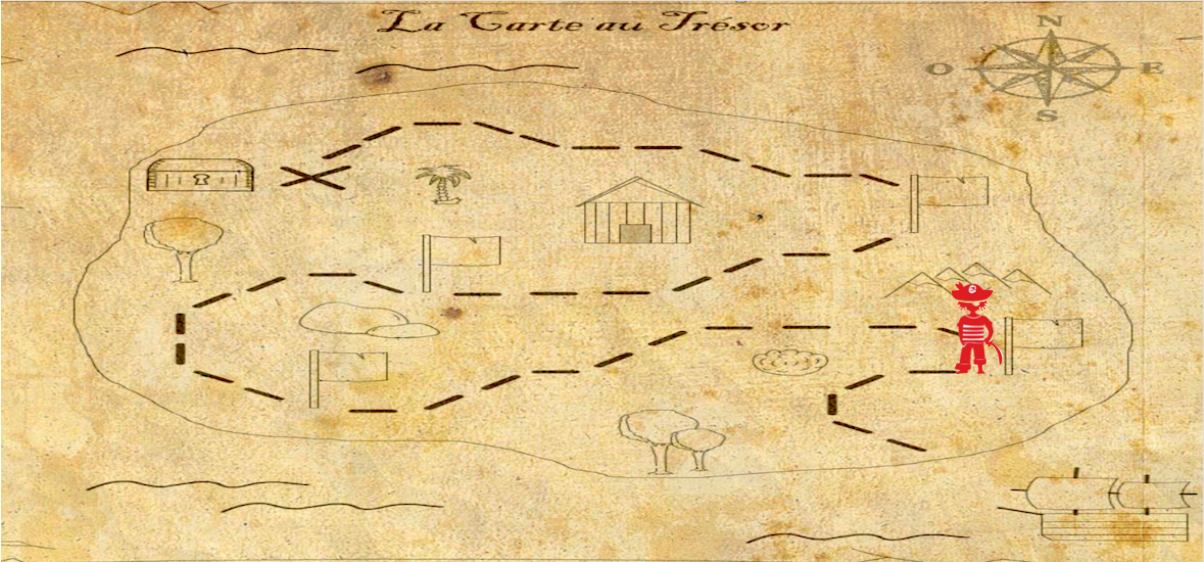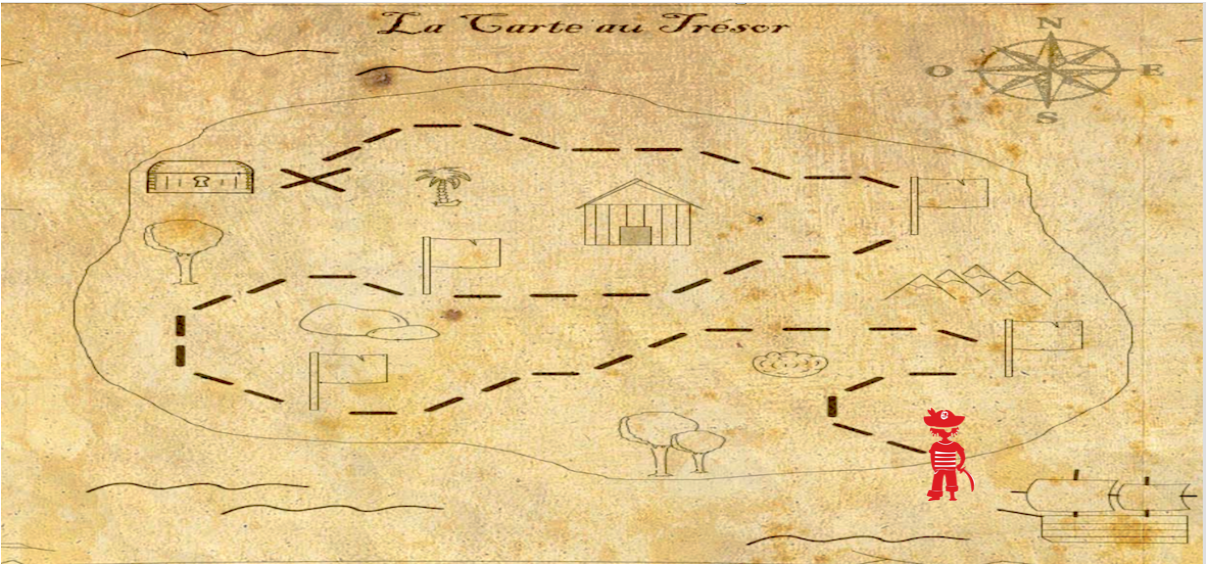La biopiraterie est un terme nouveau. Il est employé pour la première fois en 1993 par Pat Roy Mooney, un militant écologiste de la Rural Advancement Foundation International (ONG internationale qui participe à la protection des droits des peuples). La dénomination « biopiracy » a ensuite été relayée par de nombreux acteurs luttant contre la biopiraterie, en particulier Vandana Shiva, militante indienne emblématique de cette lutte. Malgré cela, le terme « biopiraterie » est encore peu rependu et il n’existe à ce jour pas de définition claire.
Le phénomène de la « biopiraterie » (qui sera désigné comme tel à postériori par Pat Roy Monney) s’est intensifié dans les années 80. En effet, les brevetages de principes actifs de plantes aux propriétés curatives (mais pas que) se sont multipliés durant cette période. Ces pratiques de brevetages s’inscrivent dans un cadre légal mais ont pourtant rapidement été considérées comme du vol par les sphères politique et publique et sont devenues source de controverses. Depuis les années 80, les affaires relevant de la « biopiraterie » se sont multipliés avec des cas très médiatiques comme celui du Neem, du Sacha Inchi et plus récemment de la stevia exploité par Cargill, Coca-cola et Pepsi ou encore l’affaire du quassia amara.
Parallèlement, et en réponse à toutes ces affaires, un cadre juridique s’est développé l’échelle mondiale et nationale.
1) Le concept moderne de « biopiraterie » apparaît en 1992 lors du sommet de la terre à Rio de Janeiro (entrée en vigueur en 93)

SOURCE : Le club des Argonautes
2)La convention sur la diversité biologique est rédigée et ratifiée par de nombreux États (sans que le terme « biopiraterie » n’ait toutefois été prononcé). Elle a trois grands objectifs : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.

SOURCE : entreprises-biodiversite.fr
Ce traité reconnaît la situation subie par les peuples indigènes, et essaie de normaliser l’exploitation des ressources ancestrales afin de les protéger. Cette nécessité est reconnue dès son préambule :
Reconnaissant qu’un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu’il est souhaitable d’assurer le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments,
Cependant, en 1992, il n’existe toujours pas de définition légale de la biopiraterie
3) Premier emploi du terme biopiraterie en 1993 attribué à l’écologiste Pat Mooney.
4) En 1995, la protection des obtentions végétales, partie des ressources biologiques, devient une condition préalable pour tout pays qui veut faire partie de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
L’Accord de l’OMC sur les Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC) oblige tous les pays membres à reconnaître des droits de propriété intellectuelle sur les obtentions végétales.

SOURCE : wto.org
5) Le Protocole de Nagoya « sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique » négocié au Japon en 2010
Il précise les moyens pour mettre en œuvre la Convention sur la Diversité Biologique. La question principale porte sur l’accès et le partage équitable des avantages. Le but est d’encadrer encore plus sérieusement l’accès aux ressources biologiques.

SOURCE : wikipedia.fr
Ce protocole enjoint aux États signataires de prendre des mesures pour tenter de réduire les cas de biopiraterie dans le monde, mais sans jamais utiliser le terme, toujours à travers la défense des droits des peuples autochtones.
Les auteurs de la presse journalistiques tout comme les militants anti-biopiraterie sont cependant assez sceptiques quant aux effets positifs de ce protocole. Le titre de l’article de Thomas Burelli est sans équivoque et constitue une bonne illustration de ces doutes : “Faut-il se réjouir de la conclusion du protocole de Nagoya ?” Revue juridique de l’environnement me 37, no. 1. (pour plus de détail cliquer sur l’onglet « faut-il légiférer »). Le protocole de Nagoya ne semble donc pas constituer un cadre juridique suffisant pour parer à la biopiraterie. Carence que tentera de combler la loi sur la biodiversité de 2016 en France.
6) La loi sur la biodiversité du 8 août 2016
Elle prévoit la création de l’Agence française pour la biodiversité, la mise en œuvre du protocole de Nagoya, le renforcement du dispositif de compensation, de nouveaux outils juridiques de protection ainsi qu’un durcissement des sanctions (un million d’euros d’amande pour le constat d’un acte de biopiraterie).
| Page précédente | Page suivante |