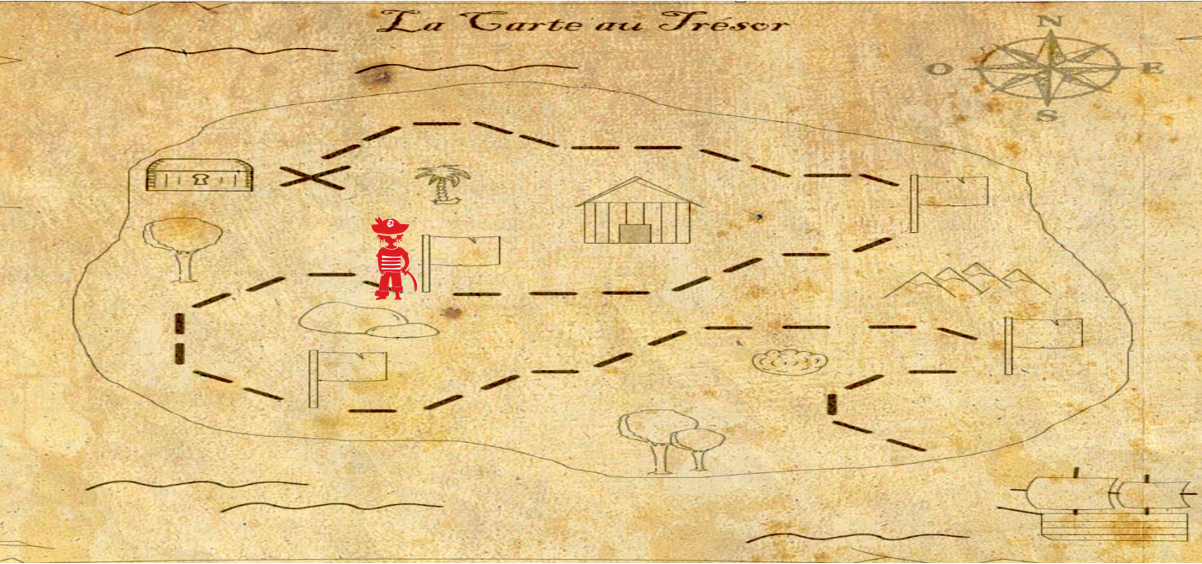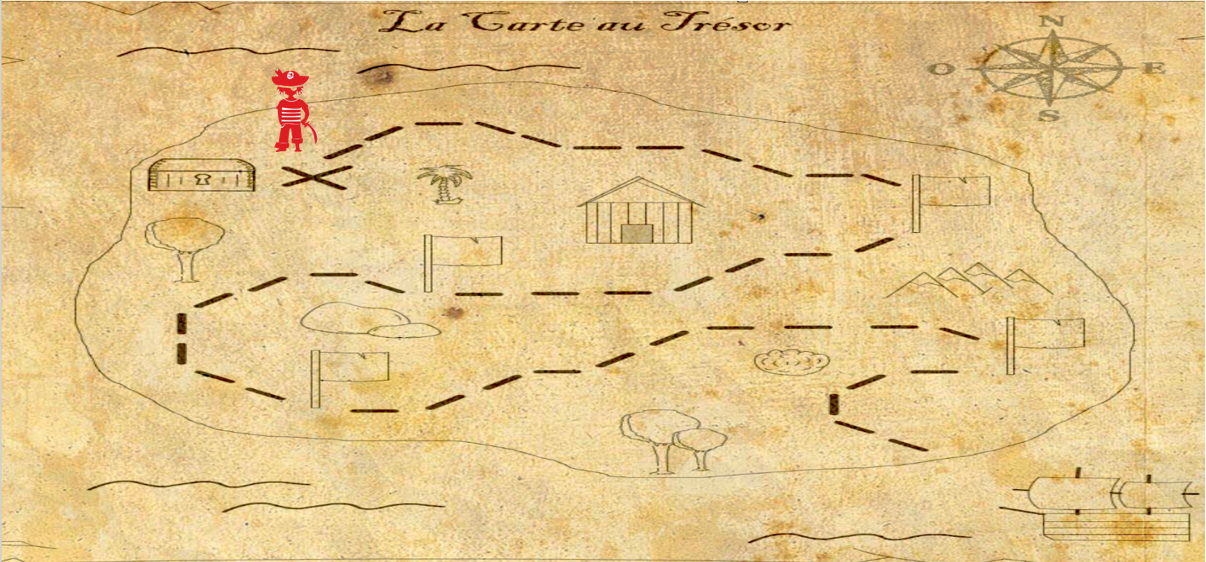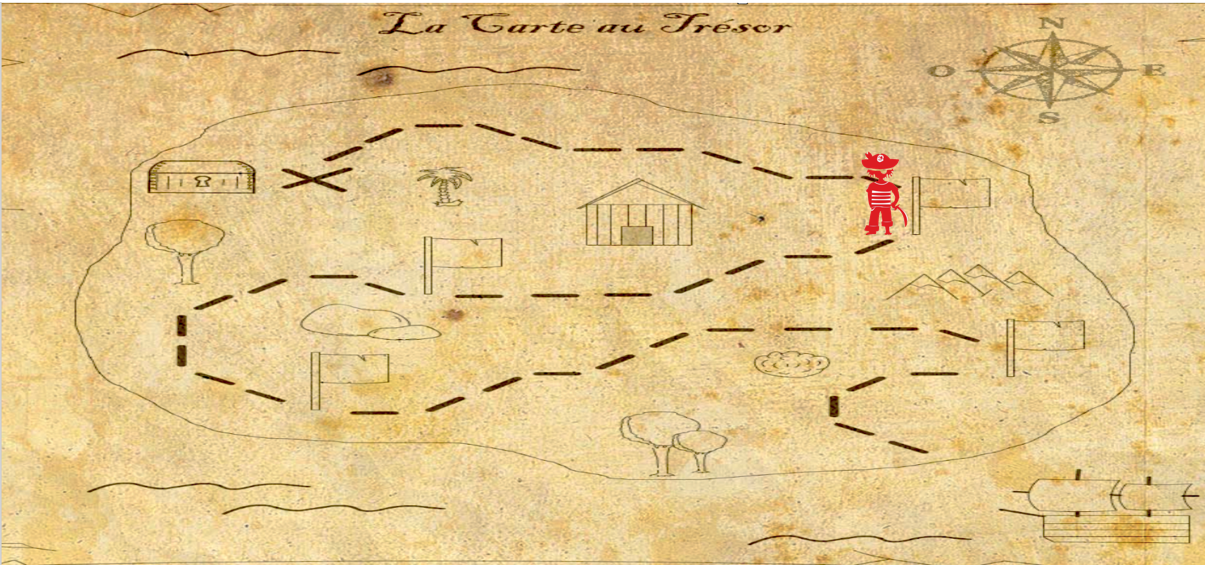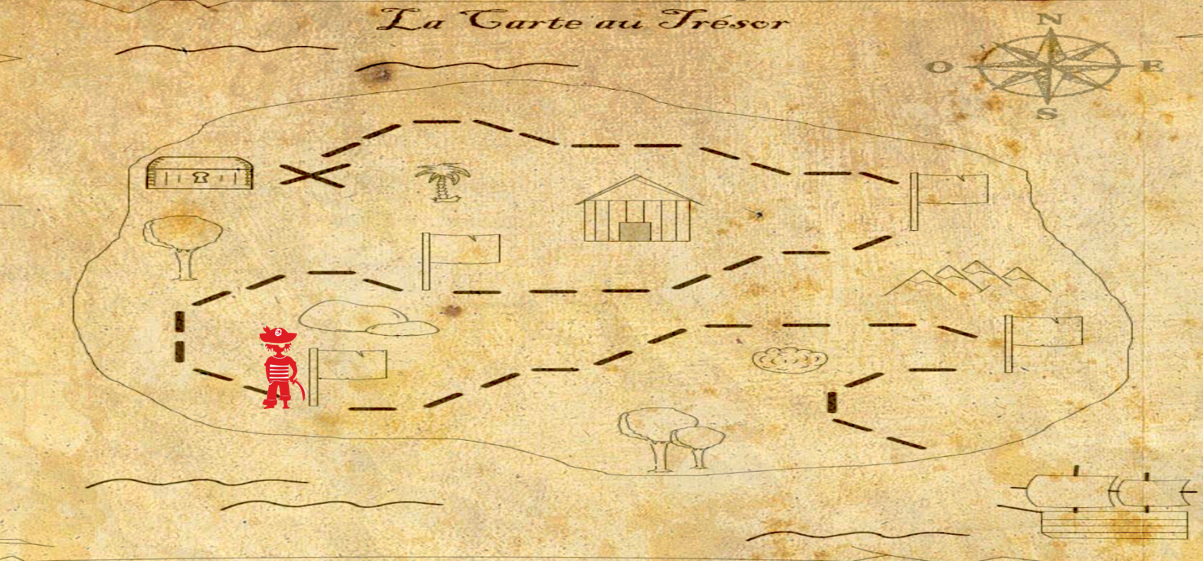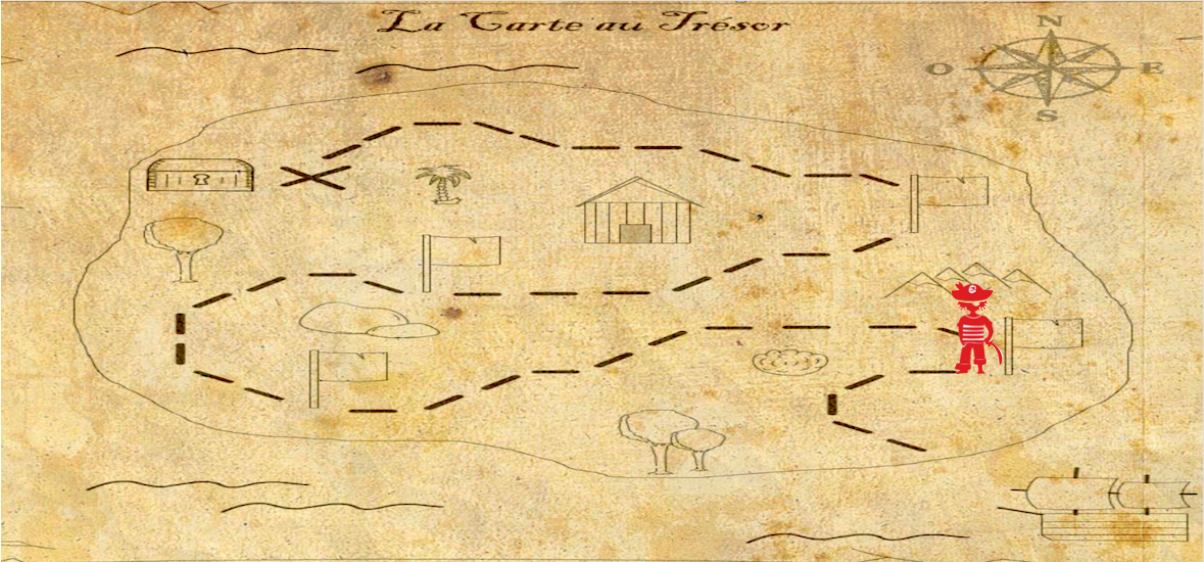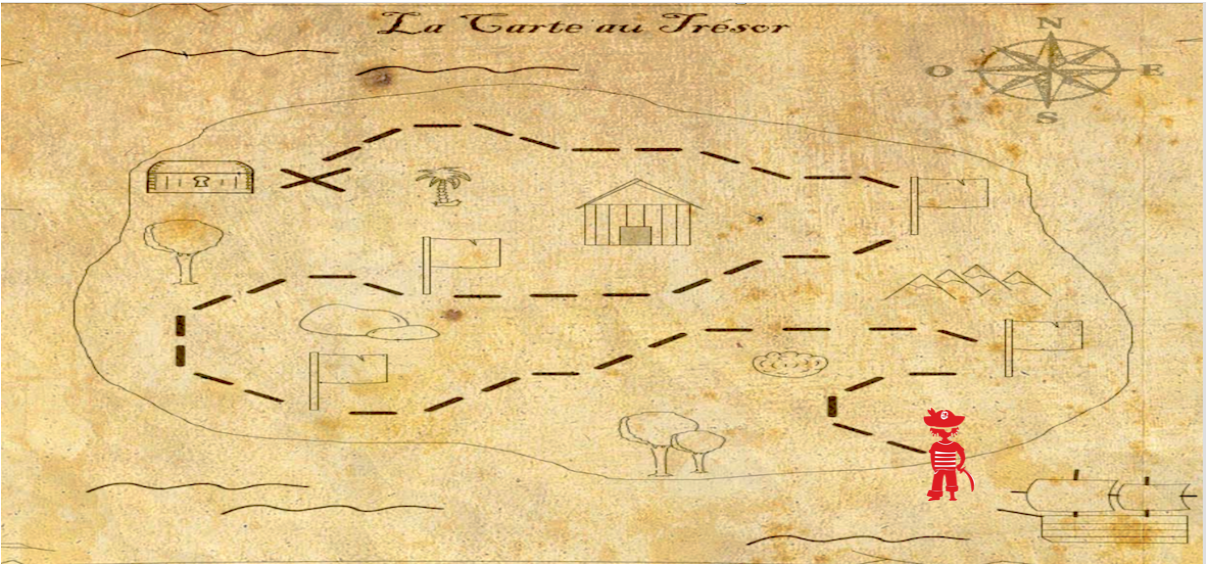Certains chercheurs détracteurs de la biopiraterie considèrent que ce terme ne bénéficie pas encore d’une définition assez claire et qu’un cadre juridique plus spécifique devrait se développer afin de faire bénéficier les agents de la lutte contre la biopiraterie d’outils juridiques adaptés. Notamment, il n’existe pas d’instance spécifique chargée de traiter les cas de « biopiraterie » et donc pas de sanction adaptée, voire même pas de sanction du tout.
Ce point de vue est développé notamment par Joseph Djemba Kandjo et Konstantia Koutouki au sein de leur article intitulé « La nécessité d’associer la biopiraterie à la criminalité environnementale en droit international ». Ils montrent que la biopiraterie échappe encore au domaine d’infractions des crimes contre l’environnement comme défini par le droit international. En effet, la biopiraterie n’est pas soumise aux règles actuelles du Droit pénal international de l’environnement (DPIE). Les deux auteurs affirment notamment que :
Puisqu’aucun texte international n’incrimine la biopiraterie, elle continue donc d’échapper au régime de sanctions prévu par le DPIE et les préjudices qui en résultent ne font l’objet d’aucune réparation.
Il y a donc nécessité de soumettre la biopiraterie à la compétence des règles du DPIE .

SOURCE : rse-magazine.com
D’ailleurs, les chercheurs, à l’image de Catherine Aubertin dans son article « Ce que ne disent pas les dénonciations de biopiraterie » mettent en avant le fait que le cadre juridique est peu développé et que donc, non seulement les chercheurs ne sont pas forcément au courant de la législation encadrant les pratiques de recherche, mais aussi les accusations portées à leur encontre ne reposent que sur la défense de certaines valeurs subjectives et non pas sur des fondements juridiques. Aucune infraction ne serait donc caractérisable. Dans son article, Catherine Aubertin s’exprime en ces termes :
Replaçons les faits dans leur contexte : les chercheurs mis en cause ont longtemps pratiqué leur métier en l’absence de procédures et de législations établies. Leurs accusateurs ne mobilisent d’ailleurs pas des infractions aux lois locales ou nationales pour fonder leurs accusations. Ils se posent avant tout en défenseurs de l’éthique, les chercheurs étant supposés, dans ce jeu de rôle des bons contre les méchants, n’en avoir aucune.
A l’inverse, certains considèrent que le cadre juridique permettant de lutter contre les actes de « biopiraterie » est largement suffisant. Il faudrait déjà commencer par utiliser les instruments juridiques nationaux les plus connus et les plus facilement accessibles avant de créer un cadre juridique trop volumineux et complexe. Ce point de vue est notamment développé par Thomas Burelli, le professeur de droit de l’université d’Ottawa spécialisé dans la propriété intellectuelle que nous avons interrogé.
Il concède qu’il n’existe pas à ce jour de définition claire et reconnue par tous de la biopiraterie et que la France est un pays globalement peu développé juridiquement dans les domaines de l’éthique et des populations autochtones. Selon lui, le code éthique du CNRS est le seul code éthique français qui traite spécifiquement de la question du droit des peuples autochtones et de leur patrimoine en recherche. Cependant, ce n’est pas parce qu’il n’existe pas de loi française spécifique que les pratiques de biopiraterie ne sont pas réglementées selon lui.
Le droit a horreur du vide. L’expression de « vide juridique » est ainsi très souvent utilisée de manière abusive. À mon sens, il existe déjà de nombreux principes et mécanismes juridiques qui permettent de traiter des pratiques de biopiraterie. Nous l’avons notamment montré avec la Fondation France Liberté en contestant plusieurs brevets en utilisant les procédures existantes dans le champ de la propriété intellectuelle. De la même manière, le droit permet le développement d’instruments par les acteurs sociaux. C’est en utilisant cette possibilité que nous avons rédigé avec Tamatoa Bambridge et les chercheurs du Criobe-CNRS (Centre de Recherches Insulaires et OBservatoire de l’Environnement) en Polynésie française le premier code éthique traitant des recherches impliquant les populations autochtones et leur patrimoine culturel.
En effet, il considère qu’il existe déjà des outils juridiques simples et connus de tous, comme le droit d’auteur ou la propriété intellectuelle, qui pourraient permettre de lutter efficacement contre la biopiraterie mais qui ne sont pourtant pas utilisés
Lorsque des étudiants assistent à un cours à l’université, il leur est interdit de produire un polycopié sans l’accord du professeur, car il est protégé par son droit d’auteur. Je pense que c’est exactement la même chose avec les productions intellectuelles des communautés. Il faut ainsi respecter leur consentement quand on exploite par exemple leurs savoirs traditionnels ou d’autres éléments de leur patrimoine culturel immatériel. Cela me semble absolument basique et logique. Il s’agit de droits reconnus par exemple aux professeurs d’université, je ne vois pas pourquoi ils ne s’appliquent pas lorsque les chercheurs collaborent pas les communautés autochtones. Il faut d’ailleurs souligner qu’entre collègues, les chercheurs respectent généralement des règles en matière de propriété des connaissances très claires et qui reconnaissent les droits respectifs de chacun. Ces droits font la plupart du temps l’objet de contrats, notamment lors de l’accueil au sein d’un laboratoire de recherche.
Concernant l’argument de Catherine Aubertin évoqué plus haut et celui de l’IRD selon lequel les chercheurs n’étaient « pas au courant », il estime que c’est un peu facile de la part de cet institut que d’affirmer que tant qu’il n’y avait pas de lois spécifiques, il avait le droit d’exploiter les ressources ancestrales des autochtones librement. En effet, le professeur considère qu’il n’y a pas besoin de lois spécifiques pour savoir qu’en droit français, on est censé respecter le consentement des personnes avec qui on conclut un contrat. Cette obligation d’échange de consentements est censée être connue de tous, d’autant plus que l’IRD compte en ses rangs bon nombre de juristes compétents.
À court terme, le professeur ne voit donc pas la nécessité de développer un cadre juridique trop complexe.
Je ne suis pas convaincu que le plus urgent soit de développer un cadre juridique spécifique, notamment une par la voie législative. Je pense que cela arrivera inévitablement à long terme. Je pense que nos efforts devraient pour le moment se concentrer sur la production d’outils très simples et rapides à produire à l’échelle locale, c’est-à-dire des contrats et des codes éthiques. Ce sont des types d’outils qui peuvent avoir un impact très important sur pratiques des acteurs locaux
Pour l’instant, il préfère se baser entre autres sur la propriété intellectuelle, le droit d’auteur, les initiatives locales, les contrats et les codes éthiques qui sont selon lui des solutions plus adaptées pour l’instant, beaucoup moins onéreuses (comparativement aux coûts engendrés par la création d’une nouvelle législation), plus facilement accessibles et parfois plus efficaces.
En ce qui concerne les moyens de prévenir les actes de biopiraterie, dans la mesure où les sanctions pénales sont très hypothétiques, il estime qu’il faut jouer sur la réputation des instituts de recherche et des entreprises. Les attaques à la réputation revêtent selon lui un caractère particulièrement dissuasif puisque personne ne souhaite investir dans un brevet qui se trouve au cœur d’accusations de biopiraterie. Là est la véritable sanction selon lui. Il faudrait également responsabiliser les chercheurs et les communautés. Il accorde un rôle prépondérant à ces dernières dans la lutte contre la biopiraterie et s’exprime en ces termes:
Il est très important de rappeler et d’insister sur le fait que les communautés peuvent imposer leurs conditions aux chercheurs en développant leurs propres outils comme des codes éthiques ou des contrats. Les communautés n’ont par ailleurs aucune obligation de collaborer dans le cadre des projets de recherche qui leur sont proposés. Elles peuvent choisir les sujets et projets qui les intéressent (certaines communautés au Canada font cela) et imposer leurs conditions.
Il nous donne à ce titre un exemple :
J’ai été amené à contacter des communautés autochtones au Canada dans le cadre de mes travaux de recherche. Je me suis alors présenté muni de mon certificat d’éthique obtenu auprès de l’université d’Ottawa. Certaines communautés m’ont répondu que mon certificat n’avait aucune valeur. Elles m’ont donc demandé de compléter leurs propres procédures d’évaluation éthique et m’ont délivré une nouvelle autorisation. Il s’agit pour moi, d’un signe de vitalité culturelle et juridique très encourageant
Enfin certains considèrent que la biopiraterie n’a pas d’existence réelle. Un cadre juridique qui lui serait spécifique relèverait donc de l’absurde. Voir « la biopiraterie existe-t-elle ? ».
La question de savoir s’il faut légiférer ou non fait donc débat et n’est toujours pas pleinement résolue. Il s’avère en effet difficile de légiférer des pratiques se rapportant à une catégorie dont les contours ne sont pas clairement définis. Mais la « biopiraterie » n’est pas le seul terme à faire l’objet de luttes de définition: la catégorie de « peuple autochtone » est également discutée et la question de la représentation et des revendications de ces communautés constitue un autre point saillant de cette controverse (voir « représentation et revendication des autochtones« ).
| Page précédente | Page suivante |